Revue Lignes, Fécamp, n° 66 : « Littérature : quelle est la question ? », octobre 2021, 208 pages, 20 €, ISBN : 978-2-35526-203-6. [Voir notre première présentation]
« Nous pouvons, comme il se doit, désespérer (désespérer
de la littérature, désespérer de la foule qui ne cesse de reculer
le moment de se changer en « peuple » ou en multitude, désespérer
des amis quand ils lâchent la guerre des formes, la « rage de
l’expression », etc.) mais ce qui est sûr, c’est que tous ne dorment pas »
(Nathalie Quintane, « La Nouvelle Autonomie », p. 108).
Depuis l’après Seconde guerre mondiale, notre modernité se décline en une série de questions plus ou moins inquiètes et conservatrices / novatrices. En voici quelques-unes :
Qu’est-ce que la littérature ?
[Jean-Paul Sartre, Gallimard, 1948]
Que peut la littérature ?
[Interventions de Beauvoir, Berger, Faye, Ricardou, Sartre
et Semprun. 10/18, 1965]
À quoi sert la littérature ?
[Danièle Sallenave, Textuel, 1997]
Que peut (encore) la littérature ?
[La Nouvelle Revue Française, n° 609, septembre 2014]
Ce type de questionnement n’est possible que si, pour le dire à la façon de Christophe Hanna – sur lequel on reviendra ci-dessous –, la notion de littérature, surtout lorsqu’elle fait la part belle à la poésie, ou mieux qu’elle se trouve régénérée par cette dernière (hypothèse avancée par 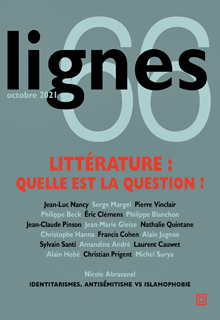 ce dossier de Lignes), « persiste non seulement à exister en tant que notion active, mais encore, et ce de toute évidence, à nourrir un imaginaire très spécifique de l’acte d’écriture et de sa fonction sociale. » Mais, comme le fait remarquer Éric Clémens dans l’article sans doute le plus brillant de cette livraison spéciale, aujourd’hui « faut-il s’étonner qu’une fonction assignée à la littérature – de divertissement ou d’engagement, de témoignage subjectif ou d’édification objective, de sensibilité ou de séduction, de subversion ou de connaissance, de création formelle ou de récit(ation) traditionnel(le)… – provoque une déception ? » (p. 55-56). Contre le fonctionnalisme capitaliste et contre les stratégies déceptives des modernes formalistes (du Nouveau Roman à Oulipo, entre autres), dans une optique à la fois nietzschéenne, bataillienne et deleuzienne, le philosophe de TXT propose la dépense, « acéphale, sans capitalisation » : « »Négativité sans emploi« , elle dilapide, elle libère de toute restriction ou soumission (subjectivation), elle excède non pas les limites […], mais à la limite » (59). Pour lui, cette « déceptivité créatrice, excès à la limite« , s’opère par et pour une poétique singulière.
ce dossier de Lignes), « persiste non seulement à exister en tant que notion active, mais encore, et ce de toute évidence, à nourrir un imaginaire très spécifique de l’acte d’écriture et de sa fonction sociale. » Mais, comme le fait remarquer Éric Clémens dans l’article sans doute le plus brillant de cette livraison spéciale, aujourd’hui « faut-il s’étonner qu’une fonction assignée à la littérature – de divertissement ou d’engagement, de témoignage subjectif ou d’édification objective, de sensibilité ou de séduction, de subversion ou de connaissance, de création formelle ou de récit(ation) traditionnel(le)… – provoque une déception ? » (p. 55-56). Contre le fonctionnalisme capitaliste et contre les stratégies déceptives des modernes formalistes (du Nouveau Roman à Oulipo, entre autres), dans une optique à la fois nietzschéenne, bataillienne et deleuzienne, le philosophe de TXT propose la dépense, « acéphale, sans capitalisation » : « »Négativité sans emploi« , elle dilapide, elle libère de toute restriction ou soumission (subjectivation), elle excède non pas les limites […], mais à la limite » (59). Pour lui, cette « déceptivité créatrice, excès à la limite« , s’opère par et pour une poétique singulière.
La question, posée cette fois par la revue Lignes – toujours en première ligne pour aborder les problématiques cruciales de notre temps –, peut se reformuler ainsi : De quoi est-il encore question quand on parle de « littérature » ?
Comment ne pas la remettre en question dès lors « qu’on ne voit plus les formes former une question, et les langues être de plus en plus rares à s’opposer à celles qui dominent » (Michel Surya) ? Et le directeur de la revue de poursuivre : « quelles questions pose-t-elle encore à ce qui est (qu’on dit définitif), et lesquelles lui poser pour que ce qui est s’en ressente (qu’il cesse de l’être) ? » (p. 7). Car la « question telle qu’il s’agirait de la reprendre ici n’est pas : à quoi la littérature (le récit, le roman, le poème, la pensée même) sert-elle ou ne sert-elle plus ? Pas non plus : à quoi est-elle utile ou ne l’est-elle plus ? Mais : qu’est-ce qui ne s’y passe plus, de quoi n’est-elle apparemment plus l’enjeu – à supposer qu’il doive s’y passer quelque chose, ou qu’un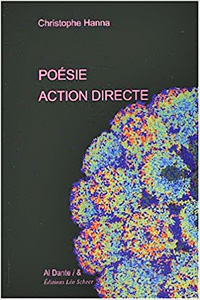 enjeu en dépende ? » (p. 6). En se départant du ton polémique propre à Salut les modernes (P.O.L, 2000), l’avant-gardiste Christian Prigent interpelle ainsi les créateurs et défenseurs du pôle autonome : « à qui entendent parler ceux qui aujourd’hui écrivent à distance de la commande mondaine et des produits pré-formatés par les médiatisations ? pour transmettre quelle expérience ? pour éventuellement produire, ce faisant, quel effet (transformateur, émancipateur – voire au sens politique) ? » (6). Étonnamment, il fait écho au préambule d’un brillant essai signé par l’une des figures de proue de la génération suivante, Poésie action directe de Christophe Hanna (Al dante & Léo Scheer, 2003), que rappelle Jean-Marie Gleize dans sa propre contribution : « Quels sont les moyens d’action positive auxquels, non risiblement, la poésie actuelle peut prétendre ? » Dans « Pour une écriture impliquée ou les projectiles », le directeur de la revue Nioques établit d’abord deux constats : d’une part, la poésie est devenue une pratique minoritaire et mineure dont la portée sociale est purement théorique ; d’autre part, l’oppression a changé de nature, désormais symbolique (ce que Bernard Noël
enjeu en dépende ? » (p. 6). En se départant du ton polémique propre à Salut les modernes (P.O.L, 2000), l’avant-gardiste Christian Prigent interpelle ainsi les créateurs et défenseurs du pôle autonome : « à qui entendent parler ceux qui aujourd’hui écrivent à distance de la commande mondaine et des produits pré-formatés par les médiatisations ? pour transmettre quelle expérience ? pour éventuellement produire, ce faisant, quel effet (transformateur, émancipateur – voire au sens politique) ? » (6). Étonnamment, il fait écho au préambule d’un brillant essai signé par l’une des figures de proue de la génération suivante, Poésie action directe de Christophe Hanna (Al dante & Léo Scheer, 2003), que rappelle Jean-Marie Gleize dans sa propre contribution : « Quels sont les moyens d’action positive auxquels, non risiblement, la poésie actuelle peut prétendre ? » Dans « Pour une écriture impliquée ou les projectiles », le directeur de la revue Nioques établit d’abord deux constats : d’une part, la poésie est devenue une pratique minoritaire et mineure dont la portée sociale est purement théorique ; d’autre part, l’oppression a changé de nature, désormais symbolique (ce que Bernard Noël 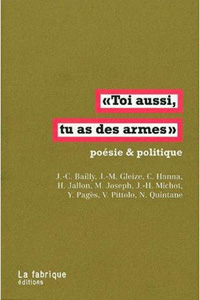 nomme la « castration mentale »). Les anciennes postures de contestation s’avérant inopérantes (« littérature engagée », « poésie politique », etc.), la « réintroduction d’une visée pragmatique-politique » (p. 95) présuppose de nouveaux dispositifs, comme ceux que proposent « les pratiques néo-poétiques ou post-poétiques » (Julien Blaine, Joël Hubaut, Jean-Michel Espitallier, Manuel Joseph, Nathalie Quintane, Christophe Hanna, A. C. Hello, Sylvain Courtoux, Amandine André, et bien d’autres). D’où le lancement, en 2011 aux éditions de La Fabrique, de l’ouvrage collectif « Toi aussi, tu as des armes ». Poésie & politique (Bailly, Gleize, Hanna, Jallon, Joseph, Michot, Pagès, Pittolo, Quintane). Pour ce qui est de Christophe Hanna, dans l’expérience qu’il rapporte (« Commande mondaine / pré-formatage / médiatisations / expérience / effets ? »), sa démarche est subversive, dans la mesure où il s’efforce « d’embarquer le média demandeur dans [son] écriture » (112).
nomme la « castration mentale »). Les anciennes postures de contestation s’avérant inopérantes (« littérature engagée », « poésie politique », etc.), la « réintroduction d’une visée pragmatique-politique » (p. 95) présuppose de nouveaux dispositifs, comme ceux que proposent « les pratiques néo-poétiques ou post-poétiques » (Julien Blaine, Joël Hubaut, Jean-Michel Espitallier, Manuel Joseph, Nathalie Quintane, Christophe Hanna, A. C. Hello, Sylvain Courtoux, Amandine André, et bien d’autres). D’où le lancement, en 2011 aux éditions de La Fabrique, de l’ouvrage collectif « Toi aussi, tu as des armes ». Poésie & politique (Bailly, Gleize, Hanna, Jallon, Joseph, Michot, Pagès, Pittolo, Quintane). Pour ce qui est de Christophe Hanna, dans l’expérience qu’il rapporte (« Commande mondaine / pré-formatage / médiatisations / expérience / effets ? »), sa démarche est subversive, dans la mesure où il s’efforce « d’embarquer le média demandeur dans [son] écriture » (112).
La question que pose Jean-Marie Gleize renvoie à un contexte évoqué dans d’autres contributions : « une poésie qui se veut efficiente, agissante, est-elle contrainte de renoncer à toute innovation, à toute audace, et de se replier sur ce que le plus grand nombre peut entendre parce qu’il en reconnaît les caractéristiques qu’il a apprises à l’école ? » (91). L’heure est en effet  à une « dé-spécification de la littérature » (Quintane, 107) que décrit – et manifestement défend – Alexandre Gefen dans son récent essai L’Idée de littérature (Corti, 2021) : la démocratisation de la littérature, consubstantielle à l’anti-élitisme ambiant, s’accompagne d’une inéluctable extension de son domaine (ateliers d’écriture, blogs, réseaux sociaux, etc.) ; cette désacralisation de la littérature qui conduit à l’éclectisme a pour corollaire une redéfinition de l’objet comme de l’histoire littéraire, et par là même un plaidoyer pour une littérature de conciliation et de consolation, de réparation et d’intervention. D’où cette interrogation de Nathalie Quintane sur les nouveaux adeptes de l’écriture : « Mais veulent-ils être auteurs ? Ou simplement auteurs de leur vie – de la vie qu’on leur vole ? » (108). Quant à Amandine André, qui oppose le comme si de la littérature à l’omniprésent et omnipotent storytelling, c’est bien le triomphe du post- qu’elle vise (posthistoire, postlittérature et postcritique) : « Il apparaît évident que ceux qui en appellent à une fin de l’histoire sont aussi ceux qui font que l’époque se clôture sur elle-même, voulant par là que rien ne leur survive » (149). La stratégie réactionnaire est évidente : de la déploration à l’autopromotion (Finkielkraut, Millet). La fin de l’histoire et de la littérature étant décrétée, fini le passé glorieux mais aussi les avant-gardes ; restent la nostalgie et la certitude d’être le dernier écrivain (Millet). Pour ce qui est de la stratégie des pseudo-progressistes (Alexandre Gefen, Johan Faerber, Pierre Vinclair), elle est plus fallacieuse : en ce temps de néo-darwinisme, il importe de s’adapter – au monde nouveau, à de nouveaux publics, à de nouvelles poétiques… Cette littérature d’adaptation est bien évidemment une littérature de renoncement (Lettres et Néant).
à une « dé-spécification de la littérature » (Quintane, 107) que décrit – et manifestement défend – Alexandre Gefen dans son récent essai L’Idée de littérature (Corti, 2021) : la démocratisation de la littérature, consubstantielle à l’anti-élitisme ambiant, s’accompagne d’une inéluctable extension de son domaine (ateliers d’écriture, blogs, réseaux sociaux, etc.) ; cette désacralisation de la littérature qui conduit à l’éclectisme a pour corollaire une redéfinition de l’objet comme de l’histoire littéraire, et par là même un plaidoyer pour une littérature de conciliation et de consolation, de réparation et d’intervention. D’où cette interrogation de Nathalie Quintane sur les nouveaux adeptes de l’écriture : « Mais veulent-ils être auteurs ? Ou simplement auteurs de leur vie – de la vie qu’on leur vole ? » (108). Quant à Amandine André, qui oppose le comme si de la littérature à l’omniprésent et omnipotent storytelling, c’est bien le triomphe du post- qu’elle vise (posthistoire, postlittérature et postcritique) : « Il apparaît évident que ceux qui en appellent à une fin de l’histoire sont aussi ceux qui font que l’époque se clôture sur elle-même, voulant par là que rien ne leur survive » (149). La stratégie réactionnaire est évidente : de la déploration à l’autopromotion (Finkielkraut, Millet). La fin de l’histoire et de la littérature étant décrétée, fini le passé glorieux mais aussi les avant-gardes ; restent la nostalgie et la certitude d’être le dernier écrivain (Millet). Pour ce qui est de la stratégie des pseudo-progressistes (Alexandre Gefen, Johan Faerber, Pierre Vinclair), elle est plus fallacieuse : en ce temps de néo-darwinisme, il importe de s’adapter – au monde nouveau, à de nouveaux publics, à de nouvelles poétiques… Cette littérature d’adaptation est bien évidemment une littérature de renoncement (Lettres et Néant).
Parmi les nouvelles poétiques d’adaptation figure l’écopoétique (impossible n’est pas éco-, n’est-ce pas ?), représentées dans ce volume par Jean-Claude Pinson et Pierre Vinclair – dont la présence ici peut surprendre vu la liquidation qu’il entreprend des dernières avant-gardes, et donc du groupe TXT dirigé par Christian Prigent. Non sans intelligence ni humour, mais au mépris de toute connaissance un peu précise de l’histoire littéraire et de l’enseignement de la littérature aujourd’hui dans le secondaire et le supérieur, l’auteur de Agir non agir (Corti, 2020) bricole une opposition artificielle et fallacieuse entre radicalité d’avant-garde et radicalité intéressante : élitiste et idéaliste, la première n’a aucune prise sur la réalité et ne saurait donc avoir de lecteurs ; la seconde propose à de vrais lecteurs « un véritable travail intellectuel » (39)… On se pince pour en croire ses yeux : mais quel « travail intellectuel » les textes écopoétiques engendrent-ils ? Quand on est normalien, pourquoi fantasmer une absence de lectorat et de réception au sein de l’Ecole, alors qu’on sait pertinemment que Novarina et Prigent sont lus et traduits dans trois continents et que, des classes préparatoires au doctorat, ils font l’objet de multiples travaux ? Au reste, que penser de cette définition : « Poésie radicale est celle qui cherche à trouver solutions aux problèmes de l’époque dans le poème » (33) ? Comme le rappelle Alain Jugnon, « la littérature pose nécessairement problème (ou bien elle n’est pas la littérature) ». Et pour lui elle pose problème « à l’orée de ce nouveau théâtre que nous réalisons, quand nous jouons radicalement notre humanimalité » (136-137).
Terminons par le texte de Laurent Cauwet, « Poésie peau morte », en droite ligne de son essai La Domestication de l’art (La Fabrique, 2017). Si le fil rouge du dossier est le renouvellement de la littérature par la poésie, encore faudrait-il savoir de quel type de poésie il s’agit… Car les pratiques évoquées plus haut mises à part, l’espace semble en voie de désertification : « Poète est devenu un métier. Et l’institution, un immense vestiaire où qui veut faire carrière choisit son costume, sa défroque, son bleu (de travail) » (158). La seule visée du poèteTM semble de se tailler un habit pour habiter en poète dans l’entreprise-culture. Mais à quoi bon se battre si l’enjeu est d’être larbinisé par l’entreprise-culture ? Pourquoi prétendre écrire pour tous, alors que la réception de la poésie est par essence limitée ?
de la littérature par la poésie, encore faudrait-il savoir de quel type de poésie il s’agit… Car les pratiques évoquées plus haut mises à part, l’espace semble en voie de désertification : « Poète est devenu un métier. Et l’institution, un immense vestiaire où qui veut faire carrière choisit son costume, sa défroque, son bleu (de travail) » (158). La seule visée du poèteTM semble de se tailler un habit pour habiter en poète dans l’entreprise-culture. Mais à quoi bon se battre si l’enjeu est d’être larbinisé par l’entreprise-culture ? Pourquoi prétendre écrire pour tous, alors que la réception de la poésie est par essence limitée ?
Si l’on peut regretter qu’une bonne partie des articles ne traitent pas vraiment la problématique abordée, cependant gageons que cette livraison restera comme un état des lieux intéressant d’un état du champ contemporain.
![[Chronique] Littérature : quelle est la question ? (Lignes, n° 66), par Fabrice Thumerel](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/09/couv_lignes_66.jpg)

![[Chronique] Littérature : quelle est la question ? (Lignes, n° 66), par Fabrice Thumerel](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/11/band-livresTourbillon.jpg)