Grand lecteur, Jean-Claude Pinson nous offre ses notes de lectures – et même d’exposition – pour terminer l’année de la meilleure façon qui soit…
► Exposition « Ilya REPINE (1844-1930) : Peindre l’âme russe », Petit Palais à Paris jusqu’au 23 janvier 2022.
Une exposition magnifique. L’œuvre considérable d’un peintre considérable, trop longtemps négligé (du moins hors de Russie).
 Bien à tort, on a considéré, j’ai considéré, qu’il n’y avait pas d’autre échappatoire pour un « grand art », dans la période considérée (fin du XIXème–début du XXème), si l’on voulait échapper à l’imagerie grandiloquente, que de se réfugier dans l’art d’avant-garde, que de rechercher dans l’art lui-même le substitut d’une grandeur perdue. D’un côté Kandinsky et Malévitch ; de l’autre le réalisme socialiste.
Bien à tort, on a considéré, j’ai considéré, qu’il n’y avait pas d’autre échappatoire pour un « grand art », dans la période considérée (fin du XIXème–début du XXème), si l’on voulait échapper à l’imagerie grandiloquente, que de se réfugier dans l’art d’avant-garde, que de rechercher dans l’art lui-même le substitut d’une grandeur perdue. D’un côté Kandinsky et Malévitch ; de l’autre le réalisme socialiste.
On n’a pas manqué d’ailleurs de vouloir faire ainsi de Répine un simple précurseur du réalisme socialiste.
Or, cette exposition le montre, Répine échappe à cette alternative. Non seulement, il renouvelle la peinture d’histoire, lui conférant une vérité aussi bien ethnographique que psychologique (c’est un exceptionnel portraitiste), mais il campe avec un rare sens de l’instant décisif des scènes de la vie quotidienne où la puissance presque hallucinée de l’incarnation vient conforter la justesse de l’observation. Et il y parvient au prix d’une incessante et intranquille recherche quant aux moyens de son art.
Ci-dessous, le tableau photographié représente la foule lors d’une commémoration au mur des Fédérés, en 1883.

► POÉSIE DES LOINTAINS EXTRÊMES (Ou comment l’extrême contemporain se nourrit du passé et des contrées les plus éloignés).
Gilles JALLET, Sinouhay, l’Autoportrait, Monologue, automne 2021, 80 pages, 12€.
Gilles JALLET reprend, pour lui redonner vie et forme moderne (en une entreprise de « refondation poétique »), un récit en écriture hiéroglyphique datant de 20 siècles avant notre ère, le « Conte de Sinouhé ». En résultent des « poèmes en bloc » qui, tout en gardant quelque chose de la forme qu’ils ont sur le rouleau de papyrus, acquièrent une étonnante modernité poétique :
« Reviens dans la noire Egypte
tu reverras la maison royale où tu es né
tu te prosterneras face devant terre
contre la grande porte du temple royal
tu feras partie des amis de Pharaon
Maintenant te voici vieux
et tu as perdu ta virilité
Souviens-toi
et songe à ce jour où selon le rite
tu seras enseveli pour entrer
dans la lumière
On te sépare de la nuit hostile
grâce à l’huile
et aux bandelettes
tissées par Isis et Nephtys »
[Je n’ai pu hélas respecter exactement la mise en page du poème]
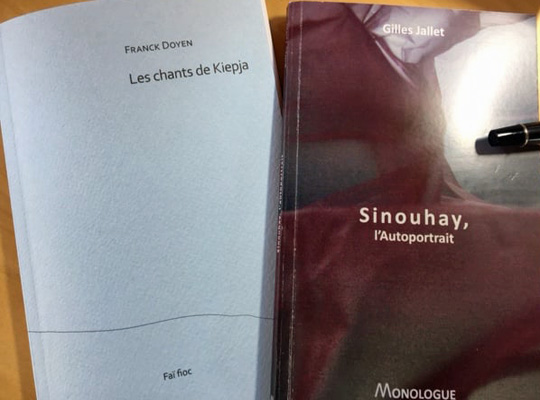
Franck DOYEN, Les Chants de Kiepja, éditions Faï Fioc, automne 2021, 88 pages, 12€.
Kiepja, morte en 1966, était une chamane selk’name (ses chants ont été enregistrés par une ethnologue, dans des conditions que ses descendants toutefois ne jugent pas acceptables).
Utilisant le lexique kawesqar, Franck Doyen a construit des récits en prose où il évoque leur mode de vie et le tragique destin (le génocide) qui les conduit à l’extinction :
« Car que reste-t-il à raconter ? Chasse, harpons arcs, coquilles de cholga, phoques et guanacos, os de baleines, cormorans feux océans, cueillette des œufs à chaque saison, les armes tirant les vôtres comme des petits lapins, hutte, canot de planches cousues : toutes choses ruines depuis, à lire ailleurs entre les virgules, dans de grands livres écrasants sous leurs bienveillances cet autre, relégué au rang de bête, et qui vogue pourtant depuis des siècles dans de longs hêtres évidés ; qui vogue entre neiges et glaces, au sein d’un enchevêtrement d’îles où les grands galions ne s’aventurent que pour s’échouer, ce chapelet d’os broyés par les mers, labyrinthe inextricable de brumes d’où maintenant seul votre chant s’élève ».
► Michel GUÉRIN, La Troisième Main. Des techniques matérielles aux technologies intellectuelles, Actes Sud, octobre 2021, 219 pages, 23 €, ISBN : 978-2-330-15591-9.
De la philosophie sans majuscule, loin de ces égarements du côté des nuées et du langage abscons dont on fait souvent grief à la philosophie.
À la façon de la phénoménologie, un retour aux choses mêmes, avec toute la rigueur souhaitée. Et en même temps, une réflexion où la création de concepts, comme le voulait Deleuze, permet de penser la question posée avec la pertinence la plus aiguë.
de penser la question posée avec la pertinence la plus aiguë.
De longue date, le projet de Michel Guérin est de penser, dans le prolongement, notamment, de Leroi-Gourhan, les gestes essentiels qui font l’humanité et son histoire. L’auteur en distingue quatre (faire, donner, écrire, danser) qui forment ce qu’il nomme une « gestique transcendantale ».
Dans cette « Troisième Main », il se penche sur le geste technique en tant qu’il ne se réduit pas à la seule préhension suivie de percussion, mais requiert le secours d’une troisième main qui permet de « main-tenir », de poser l’objet à travailler, afin de le transformer et ce faisant permet de gérer le temps.
La chose est d’importance, car elle engage en aval tout ce qui touche à l’économique et au social. L’auteur présente ainsi « l’hypothèse de son livre » : « la question de l’inégalité (pour parler comme Rousseau) ou de l’extorsion (pour le dire avec Marx) se noue dans la gestualité technique même en tant qu’elle ‘supplémente’ les percussions par les positions. À la fois le poser est consubstantiel à une technique un peu complexe et il lui ajoute immédiatement un coefficient socio-économique ; il superpose aux actions vives, tournées vers la transformation de la matière, un reste qui ne sera utile qu’en son temps’ » (p. 117).
S’ensuit toute une réflexion, passionnante, sur l’écriture (qui procède bien d’un « poser »), confrontée aujourd’hui à cette « troisième révolution graphique » que constitue l’advenue de l’informatique.
Face à l’idéologie réductionniste (et transhumaniste) qui en peut découler (tout serait réduit à un codage 0/1), à la menace d’un « Léviathan algorithmique », l’auteur plaide pour « l’alliance immémoriale de la main et de l’humain », insistant sur la nécessité de garder en tête ce qu’il nomme « l’affectivité » de la pensée, une pensée qu’il importe, en même temps que la vie, de « retirer sans compromis possible de cette immense salle des ventes qu’est devenue la terre des hommes » (p. 212). Le livre se conclut ainsi par un « Eloge de la finitude ».
Parmi bien d’autres pages, je relève celle-ci où il est question, superbement, de la danse : « La danse n’a pas de retour, ou plutôt celui-ci n’est que le re-tour du même tour, l’éternelle rotondité de la volte. Cette redondance signe à la fois sa frugale autosuffisance (elle qui est, d’un seul tenant, la matière, l’outil et l’œuvre), le désintéressement de l’œuvre d’art (« finalité sans fin »), son indexation foncière à une ‘cosmopoétique’ de l’exultation (de la joie) et de l’éternel retour, enfin ses affinités avec des sensations et des perceptions ‘inutiles’ relatives à des symétries, des rythmes et des intensités » (p. 161).
► Michel JULLIEN, Andrea de dos, éditions Verdier, à paraître le 6 janvier 2022, 128 pages, 15€.
Le sujet du récit : un pèlerinage en terrain équatorial (on reconnaît sans peine le Brésil).
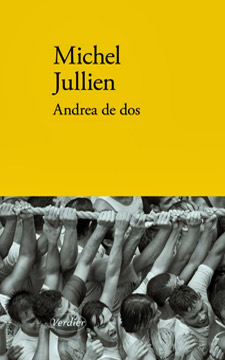 Une prose magnifique, aussi exacte que flamboyante (j’en donne un échantillon ci-dessous). Rarement vu une telle qualité de phrase et de phrasé (deux noms, et pas des moindres, me sont venus à l’esprit : Gracq et Michon).
Une prose magnifique, aussi exacte que flamboyante (j’en donne un échantillon ci-dessous). Rarement vu une telle qualité de phrase et de phrasé (deux noms, et pas des moindres, me sont venus à l’esprit : Gracq et Michon).
Un rapprochement avec Répine (« Procession religieuse dans la province de Koursk ») s’est immédiatement imposé à moi (et pas seulement parce que j’ai vu récemment l’exposition du Petit Palais). Evidente m’a semblé la parenté entre la palette du peintre « ambulant », sa façon hallucinatoire de dépasser la simple scène de genre (sans rien gommer de la vérité ethnographique) et le côté enfiévré du récit de Michel Jullien, sa couleur jubilatoire, son art du portrait et son sens du cadrage des scènes de foule.
« Les bus en ce pays sont des vivariums ambulants, des bains-marie cubiques brassant une moiteur urbaine qui se referme sur leur passage. Ils vont vitres closes sinon celle du chauffeur, une mince ouverture pour se défendre des fournaises épanouies dès les premières séquences de l’aube, alors ils roulent porte ouverte, sous l’équateur, de quoi remplir l’habitacle d’âcres mélanges. Moitié dedans, une grappe d’usagers tient au vide, sur le marchepied. Ils prétendent entrer, s’en prennent aux passagers tassés dans la travée, au-delà des portes accordéon, eux-mêmes invectivent leurs voisins, lesquels harpaillent les voyageurs assis, tout le monde se honnit, beaucoup fument, les insultes valent des bonjours, le conducteur conduit. Comme tous il crache mais ses déjets vont à l’enclos de sa cabine, sans partage. Sa musique est pour tous, poussée au comble, une radio ligotée au levier des vitesses, comme si l’amas des décibels était capable de tenir tête à l’étuvée tropicale » (p. 14-15).

![[Livres] Jean-Claude Pinson, Libr-kaléidoscope (1)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/12/band-kaleidoscopebis.jpg)