Cette réponse de Jean-Claude Pinson – que les Libr-lecteurs connaissent bien depuis des années –, suite à une chronique qui présente le contexte et le propos général de l’essai avant de se concentrer sur la dizaine de pages consacrée à Prigent et de s’interroger sur les rapports à la modernité de l’écopoétique, s’inscrit tout à fait dans la conception libr-critique du débat. [Sur l’ensemble de l’œuvre, on pourra se reporter à mon entretien avec l’auteur, en deux parties : « Poéthiquement impur… »]
Cher Fabrice,
Puisque vous m’invitez à poursuivre le dialogue, je crois utile de vous adresser ces quelques remarques sur la « chronique » que vous avez consacrée à mon essai intitulé Pastoral.
1. Je vois avant tout dans votre texte un plaidoyer ardent pour l’écriture carnavalesque de Christian Prigent. J’ai pour ce dernier, vous le savez, une réelle admiration. Toutefois, Pastoral n’est évidemment pas un essai sur son œuvre et je ne crois pas que celle-ci soit la « pierre de touche » de mon livre – et pas davantage sa « pierre d’achoppement ».
Si « pierre de touche » il y a, c’est autour d’une question qui est mienne depuis mes débuts, celle de l’habitation poétique du monde. Ce qui signifie, en allant très vite, que la forme de vie induite par la poésie compte autant pour moi que l’écriture du poème elle-même. Ou encore : au-delà du poème, il y a l’incidence, l’influence souhaitée, d’une Idée poétique (ou plus exactement « poéthique ») que la poésie porte, pour ainsi dire immémorialement, sous la forme d’une aspiration à un âge d’or. Cette Idée consonne selon moi avec la promesse émancipatoire formulée par Marx sous l’appellation d’un « règne de la liberté ». Cette convergence me semble parfaitement illustrée par un tableau de Signac que je commente dans Pastoral, tableau daté de 1895 qui porte pour titre « Au Temps d’Harmonie (L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir) ».

Cette aspiration « arcadienne » me semble la chose du monde la mieux partagée. Elle ne vaut pas pour le seul poète, mais pour l’humanité en général. Elle commence de la façon la plus banale, la plus ordinaire, dans le souci que chacun a d’aménager au mieux son lieu de vie, son habitat. Dans cette optique, le moindre jardin ouvrier est déjà un embryon d’Eden.
Au plan métaphysique, je vois dans cette aspiration la manifestation d’un sentiment d’appartenance au Grand Tout de la Phusis qui est aussi essentiel à la condition humaine que 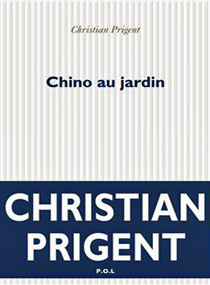 celui de la séparation (de la « partance »). Nul n’y échappe, chacun en fait l’expérience. Y compris ceux des poètes qui ont le plus vif sentiment de ce que le langage nous tient à distance du monde et de l’archi-mouvement de la Vie. C’est ce qu’il n’est pas difficile de repérer par exemple chez Ponge et que j’ai cru aussi retrouver dans l’écriture de Christian Prigent et qu’il me semble percevoir encore dans le très récent Chino au jardin, aux pages 73-75, où se trouve évoqué « l’immense enroulement de tout sur soi-même ». Que le registre où se trouve formulé ce sentiment soit par bien des côtés carnavalesque n’empêche pas que passe aussi quelque chose comme un affect pascalien du sublime (le mot est d’ailleurs employé à la page 75).
celui de la séparation (de la « partance »). Nul n’y échappe, chacun en fait l’expérience. Y compris ceux des poètes qui ont le plus vif sentiment de ce que le langage nous tient à distance du monde et de l’archi-mouvement de la Vie. C’est ce qu’il n’est pas difficile de repérer par exemple chez Ponge et que j’ai cru aussi retrouver dans l’écriture de Christian Prigent et qu’il me semble percevoir encore dans le très récent Chino au jardin, aux pages 73-75, où se trouve évoqué « l’immense enroulement de tout sur soi-même ». Que le registre où se trouve formulé ce sentiment soit par bien des côtés carnavalesque n’empêche pas que passe aussi quelque chose comme un affect pascalien du sublime (le mot est d’ailleurs employé à la page 75).
De ce constat, il ne s’ensuit aucunement que je veuille réduire Prigent à une poétique néoromantique de l’appartenance qui n’est évidemment pas la sienne. J’ajouterais d’ailleurs qu’une telle poétique n’est au demeurant nullement contradictoire avec une métaphysique matérialiste où l’éternité s’appréhende comme « éternullité », comme c’est le cas chez Leopardi.
Etudier une œuvre, ou même simplement la convoquer, ce n’est pas pour moi la ramener à toute force dans un enclos dont je serais comme le propriétaire. Le travail critique, tel que je le conçois (dans une optique qui fut celle de Walter Benjamin), ne consiste pas à se pencher sur une œuvre pour la figer et lui coller une étiquette. Elle consiste bien plutôt à s’enfoncer en elle, pour en déployer, en toute amitié, les arcanes les plus essentielles, fussent-elles méconnues de l’auteur lui-même. Forme « supérieure » de la réflexion, la critique, disait en substance Benjamin, vient « compléter », « rajeunir », l’œuvre ; elle l’élève à une puissance de réflexion supérieure qui est en puissance en elle. À quoi j’ajouterais que ce travail critique, dans la perspective de ma propre entreprise d’écriture « poétique », consiste à se comparer à ce qu’il y a de meilleur et à traiter ces autres qu’on étudie à la matière pessoenne, comme s’ils étaient des hétéronymes, des possibilités autres de soi. Ce qui signifie qu’on cherche à produire non seulement une critique immanente au texte (close reading), mais une critique intérieure (comme si elle procédait depuis la vis creativa propre à l’auteur qu’on examine). Et Christian Prigent, sous cet angle, est bien un de mes hétéronymes, comme Pierre Michon, Jude Stéfan, Pierre Bergounioux, Dominique Fourcade ou encore Stéphane Bouquet en sont d’autres (pour en rester aux seuls écrivains contemporains).
conçois (dans une optique qui fut celle de Walter Benjamin), ne consiste pas à se pencher sur une œuvre pour la figer et lui coller une étiquette. Elle consiste bien plutôt à s’enfoncer en elle, pour en déployer, en toute amitié, les arcanes les plus essentielles, fussent-elles méconnues de l’auteur lui-même. Forme « supérieure » de la réflexion, la critique, disait en substance Benjamin, vient « compléter », « rajeunir », l’œuvre ; elle l’élève à une puissance de réflexion supérieure qui est en puissance en elle. À quoi j’ajouterais que ce travail critique, dans la perspective de ma propre entreprise d’écriture « poétique », consiste à se comparer à ce qu’il y a de meilleur et à traiter ces autres qu’on étudie à la matière pessoenne, comme s’ils étaient des hétéronymes, des possibilités autres de soi. Ce qui signifie qu’on cherche à produire non seulement une critique immanente au texte (close reading), mais une critique intérieure (comme si elle procédait depuis la vis creativa propre à l’auteur qu’on examine). Et Christian Prigent, sous cet angle, est bien un de mes hétéronymes, comme Pierre Michon, Jude Stéfan, Pierre Bergounioux, Dominique Fourcade ou encore Stéphane Bouquet en sont d’autres (pour en rester aux seuls écrivains contemporains).
La modernité, comme vous semblez l’affirmer, est-elle uniquement « carnavalesque » ? Est-elle  uniquement du côté d’un négatif sans relève, d’une déconstruction sans fin ? Il y aurait lieu ici de développer la question sous l’angle philosophique. Je ne m’y attarde pas, l’ayant fait ailleurs à plusieurs reprises. Disons, pour aller très vite, qu’une poétique de l’affirmation n’est pas incompatible avec une ontologie de la différence non-logique (de l’impossible réduction du réel, en sa contingence, à quelque logos que ce soit). C’est pour avoir lu d’assez près Hegel (et Kojève à sa suite) que je crois pouvoir in fine me ranger plutôt du côté de Bataille, même si je ne partage guère, de ce dernier, son goût de Sade et de quelques autres – et pas davantage son penchant mystique (bien que m’ait retenu sa conception du sacré, que j’ai cru pouvoir utiliser dans l’essai que j’ai consacré à Pierre Michon).
uniquement du côté d’un négatif sans relève, d’une déconstruction sans fin ? Il y aurait lieu ici de développer la question sous l’angle philosophique. Je ne m’y attarde pas, l’ayant fait ailleurs à plusieurs reprises. Disons, pour aller très vite, qu’une poétique de l’affirmation n’est pas incompatible avec une ontologie de la différence non-logique (de l’impossible réduction du réel, en sa contingence, à quelque logos que ce soit). C’est pour avoir lu d’assez près Hegel (et Kojève à sa suite) que je crois pouvoir in fine me ranger plutôt du côté de Bataille, même si je ne partage guère, de ce dernier, son goût de Sade et de quelques autres – et pas davantage son penchant mystique (bien que m’ait retenu sa conception du sacré, que j’ai cru pouvoir utiliser dans l’essai que j’ai consacré à Pierre Michon).
J’ai toujours cherché pour ma part, dans mes livres de poésie (appelons-les comme cela faute de mieux), à métisser les registres ; à faire que s’entrecroisent les tonalités grinçantes, déceptives, critiques, acerbes, narquoises, de la satire et celles de l’éloge et du chant lyrique, de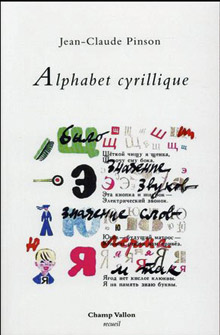 la joie et de l’élan affirmatif ; à faire coexister la gravité et le carnavalesque, le sérieux et le grotesque, le méditatif et l’humoresque. Vous pourrez me semble-t-il le vérifier si vous lisez par exemple mon Alphabet cyrillique. [Lu, en effet : ici]
la joie et de l’élan affirmatif ; à faire coexister la gravité et le carnavalesque, le sérieux et le grotesque, le méditatif et l’humoresque. Vous pourrez me semble-t-il le vérifier si vous lisez par exemple mon Alphabet cyrillique. [Lu, en effet : ici]
Mes modèles sont sans doute ici avant tout musicaux. J’ai ainsi trouvé dans le free-jazz à la fois diverses formes du carnavalesque (Ornette Coleman, Albert Ayler et quelques autres) et le grand lyrisme d’un John Coltrane. De même, m’a retenu chez Chostakovitch sa plasticité extrême, sa capacité à passer du registre le plus ironique, le plus grimaçant, le plus sardonique, au lyrisme le plus emporté ou le plus poignant, notamment dans ses quatuors à cordes ou encore dans ses 24 Préludes et Fugues pour le piano.
Vous évoquez l’idée d’une « poésie de célébration » qui serait synonyme d’emphase, d’effusion 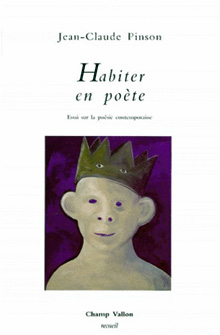 subjective et de pathos romantique. Le méchant livre de Meschonnic qui porte ce titre (Célébration de la poésie) est un livre sans intérêt, de pur pré-jugé (au sens étymologique du mot), un très médiocre pamphlet, où l’auteur tire à boulets rouges sur tout ce qui n’est pas conforme à son idée de la poésie. Si Prigent n’est pas épargné (« la vangarde poseuse, inconsciente de son académisme »), je figure dans le peloton de tête des auteurs cloués au pilori, Meschonnic ayant décidé que j’étais un heideggérien bon teint, au seul motif que le verbe « habiter » figure dans les titres de deux de mes livres (J’habite ici et Habiter en poète). De toute évidence, il n’a pas lu ces livres, n’a pas vu que dans le premier de ces titres, c’étaient les déictiques (« je », « ici »), bien peu heideggériens, qui avant tout importaient. Pire, Meschonnic cite (p. 60) fautivement (et de toute évidence de seconde main) quelques vers de ce livre (J’habite ici), au mépris du minimum de rigueur philologique qu’on serait en droit d’attendre de la part d’un linguiste.
subjective et de pathos romantique. Le méchant livre de Meschonnic qui porte ce titre (Célébration de la poésie) est un livre sans intérêt, de pur pré-jugé (au sens étymologique du mot), un très médiocre pamphlet, où l’auteur tire à boulets rouges sur tout ce qui n’est pas conforme à son idée de la poésie. Si Prigent n’est pas épargné (« la vangarde poseuse, inconsciente de son académisme »), je figure dans le peloton de tête des auteurs cloués au pilori, Meschonnic ayant décidé que j’étais un heideggérien bon teint, au seul motif que le verbe « habiter » figure dans les titres de deux de mes livres (J’habite ici et Habiter en poète). De toute évidence, il n’a pas lu ces livres, n’a pas vu que dans le premier de ces titres, c’étaient les déictiques (« je », « ici »), bien peu heideggériens, qui avant tout importaient. Pire, Meschonnic cite (p. 60) fautivement (et de toute évidence de seconde main) quelques vers de ce livre (J’habite ici), au mépris du minimum de rigueur philologique qu’on serait en droit d’attendre de la part d’un linguiste.
Surtout, la question de la célébration est évacuée plutôt que vraiment traitée. Or à mes yeux elle importe beaucoup. Que faire en effet aujourd’hui, poétiquement, avec la vieille catégorie de l’hymne, quand tout dans l’époque qui est nôtre incite à la démolition des idoles, à la décréance généralisée, au soupçon systématique, à l’expression de la détestation, au dénigrement, et même, comme on le voit avec les réseaux sociaux, à la furie de la dénonciation ? Pourtant, si l’hymne est irrémédiablement « brisé », comme le dit Agamben, n’avons-nous pas encore besoin de l’éloge ? Ne continuons-nous pas malgré tout à admirer et à vouloir donner voix au sentiment d’admiration quand il nous advient en diverses occasions, pas nécessairement de l’ordre du grandiose ? Le sens commun, en tout cas, n’a pas attendu la littérature. À cette pulsion qui porte chacun à vouloir admirer, il donne, lui, libre cours, trouvant aliment, faute de mieux, dans ce que l’industrie culturelle met à sa disposition sur le marché, à savoir les idoles du cinéma, de la chanson, des grands médias et du sport. Considérer de haut ce désir d’admirer, ne pas le prendre en compte, renoncer par avance à l’éloge et à l’hymne, à la légende, voilà qui ne me paraît pas de la meilleure politique poétique. Je crois au contraire qu’il vaut la peine encore de louer ce qui toujours surgit de beauté nouvelle – et non moins de ce qui malgré tout demeure, dans un monde ravagé, de beauté ancienne. – Même si le risque est grand, pour qui voudrait ainsi faire droit encore à l’affirmation, de chuter du côté de l’illusion et de l’idylle mensongère et naïve.
2. Quant à la « pierre d’achoppement » dont vous parlez, elle est bien réelle. Mais si l’œuvre de Prigent est ici révélatrice, ce n’est pas seulement, hélas, de mon propre embarras. C’est aussi de cette difficulté générale qui fait que la poésie « peut peu » ; que le poïen, la forgerie du poème, a bien du mal à être converti en action poétique, en praxis, même si toute une jeunesse « poétarienne » aujourd’hui s’y emploie sous la forme de ce que j’appelle « une poétique de dehors » (expression que j’emprunte à Clara Breteau).
J’aimerais bien sûr dans l’avenir pouvoir être démenti, de telle sorte que le chant poétique ne soit pas seulement ce « chant du cygne » que j’évoque à la toute fin de mon essai. La perspective mienne n’est en tout cas nullement « eschatologique » (au sens où la fin des temps conduirait à quelque chose comme une résurrection), comme vous semblez le penser. Elle est bien plutôt hantée par une apocalypse qui serait hélas, sans rémission aucune. L’athéisme mien est ici radical.
3. « Voie de la facilité », dîtes-vous, à propos de Stéphane Bouquet[i]. Voilà un jugement bien rapide. Je vois plutôt chez cet auteur, un des plus passionnants et rafraîchissants qu’il m’ait été donné de lire depuis une vingtaine d’années, une forme très revigorante de simplicité et un parti-pris audacieux de la ligne claire : le simple, vous le savez sûrement, est tout sauf le facile ; il est même ce qu’il y a de plus difficile à atteindre, au même titre que la naïveté seconde (« naïveté » au sens de Schiller) pour les Modernes que nous sommes.
Vous reprenez, de Stéphane Bouquet, une formule que je cite, tirée de son essai La Cité de paroles : « La langue, écrit-il, n’est qu’un moyen de la poésie, elle n’est en rien sa fin, son but ».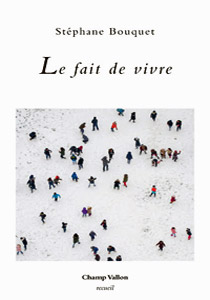 La formule, qui mériterait d’être resituée dans son contexte (un chapitre sur Cavafis), ne peut à mon sens être prise tout à fait au pied de la lettre. Elle doit être lue cum grano salis. « La langue, ajoute d’ailleurs l’auteur, est une question secondaire dans la poésie, relativement secondaire » (je souligne « relativement »). Traducteur de maints poètes américains contemporains, Stéphane Bouquet n’ignore évidemment rien du poids d’un idiome, de ses tours et détours, de ses complications opérantes (par exemple quand il analyse l’importance des parenthèses chez un auteur comme Cummings).
La formule, qui mériterait d’être resituée dans son contexte (un chapitre sur Cavafis), ne peut à mon sens être prise tout à fait au pied de la lettre. Elle doit être lue cum grano salis. « La langue, ajoute d’ailleurs l’auteur, est une question secondaire dans la poésie, relativement secondaire » (je souligne « relativement »). Traducteur de maints poètes américains contemporains, Stéphane Bouquet n’ignore évidemment rien du poids d’un idiome, de ses tours et détours, de ses complications opérantes (par exemple quand il analyse l’importance des parenthèses chez un auteur comme Cummings).
Cette secondarité relative de la langue signifie bien cependant que le poème n’est pas à lui-même sa propre fin. Au-delà de son enclos, il cherche à « inventer une forme de vie ». Le vers par exemple, écrit Bouquet, est comme « une boîte de vitesse » qui vise à « l’intensification de la vie ». Je partage pleinement une telle conception « éthopoïétique » de la poésie. Elle n’a rien à voir avec la mièvrerie que vous semblez soupçonner. L’auteur le dit très crûment (à propos de Frank O’Hara) : « le but de toute poésie est de baiser ».
J’ajoute encore ceci : la singularité de la poésie de Stéphane Bouquet tient à sa capacité à faire entendre à nouveau quelque chose qui est de l’ordre de l’hymne et de l’affirmation ; à sa capacité à donner corps « à ce grand assentiment à la vie » qui est selon lui au fond de la poésie de Cummings. Et cette célébration du simple « fait de vivre » advient chez lui (Stéphane Bouquet) en faisant l’économie de toute verticalité et de toute emphase. Elle tient aussi, cette singularité, à sa capacité à redonner un sens, en poésie, à la catégorie si difficile de « peuple », à travers ce que j’ai appelé un « communisme aléatoire ».
Au final, une poésie d’une rare fraîcheur. Elle saute d’emblée aux yeux, me semble-t-il, quand on veut bien lire sans a priori son dernier livre, Le fait de vivre (je me permets de vous renvoyez à la recension que j’ai pu en faire récemment sur ma page Facebook).
Au plaisir, cher Fabrice, de poursuive ce dialogue au long cours.
Avec mon amical salut.
J.-Cl. Pinson
[i] Simple précision : cette formule se rapporte à l’essai de zoopoétique récemment publié par Anne Simon, et non à l’œuvre de Stéphane Bouquet, que je ne taxerai d’ailleurs pas de « mièvre » – même si je suis réservé sur sa portée.
![[Lettre] Réponse de Jean-Claude Pinson à Fabrice Thumerel (Pastoral, 2/2)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/06/PinsonBackG.jpg)

![[Lettre] Réponse de Jean-Claude Pinson à Fabrice Thumerel (Pastoral, 2/2)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/06/band-pinson.jpg)