On pourra commencer cette nouvelle année par lire quelques livres intéressants publiés fin 2021…
► Martine Leibovici et Aurore Mréjen dir., Cahier Hannah Arendt, éditions de l’Herne, automne 2021, 312 pages, 33 €.
Pierre Pachet, à propos du rapport d’Hannah Arendt à la poésie : « La parole du poète, comme l’injonction des mœurs et de l’éducation n’a pas la force de la loi ; son autorité, distincte de la contrainte, tient justement à ce qu’elle laisse libre, et même à ce qu’elle dépend de la capacité de l’auditeur, du citoyen, du lecteur, à se mettre à son écoute, à reconnaître sa force. » (« L’autorité des poètes dans un monde sans autorité »).
 Bien des articles passionnants dans ce très riche Cahier de l’Herne dirigé par Martine Leibovici et Aurore Mréjen.
Bien des articles passionnants dans ce très riche Cahier de l’Herne dirigé par Martine Leibovici et Aurore Mréjen.Dans leur avant-propos elle soulignent les points suivants :
On ne peut certes négliger l’importance que Heidegger a eue pour elle, « mais nous avons pris le parti de privilégier les approches qui insistent sur l’autonomie de sa pensée par rapport à son ancien professeur et amant ».
« Les analyses de la désolation totalitaire proposées par Arendt font écho à nos inquiétudes contemporaines ». Mais il s’agit cependant « d’éviter les analogies hâtives » et de rester « attentif à l’irréductibilité de notre présent, tout en nous inquiétant de l’incapacité des Etats-nations et du droit international à garantir le « droit d’avoir des droits » aux masses de migrants et de réfugiés modernes. »
Arendt, en des sombres temps, « à l’instar de Benjamin, a gardé les yeux rivés sur la possibilité d’ ‘une chance plus grande que la catastrophe’ « .
La philosophie, saisissant l’essence de l’homme uniquement au singulier, a été aveugle à la pluralité constitutive de l’action politique et « a négligé la différenciation des activités ». Arendt a su être attentive, dans ses analyses, au fait que « la capacité d’agir est aussi une capacité de sentir, d’être affecté ; les positions proprement politiques sont irriguées par des attitudes pré-politiques comme la gratitude et le ressentiment »;
« L’importance du langage, cette trame du monde, traverse l’œuvre d’Arendt : l’action est toujours ‘agir et parler’ » […] Les exilés comme Arendt savent aussi l’importance de la langue en tant que telle. Tout en conservant une distance avec l’anglais, elle a écrit une grande partie de son œuvre de cette langue, alors que l’allemand, la langue de son ‘Denktagebuch’ [journal de pensée], est ancré au plus profond de sa mémoire, sous forme de poèmes. » […] Arendt a quitté l’Allemagne en emportant l’allemand avec elle, avant qu’il n’ait été investi comme ‘Lingua Tertii Imperii’ [Langue du troisième Reich]. C’est l’expérience de ce que pouvait être l’emprise totalitaire sur une langue qui lui est entrée dans les oreilles à l’écoute de l’allemand d’Eichmann. C’est pourquoi, aux antipodes de son emprise, nous avons besoin de l’intensité et de la plénitude du sens que seules procurent les histoires bien racontées, comme nous avons besoin des poèmes pour veiller sur la langue. »
► Olivier Barbarant, La Juste couleur. Chroniques poétiques, Champ Vallon, automne 2021, 374 pages, 25 €.
« La radio a capté une station lointaine
où un chœur d’enfants
dans une langue qui doit être du russe
lit quelque chose qui doit être de la poésie
et pourrait sonner comme une traduction
du poème que j’ai toujours rêvé d’écrire »
En ouverture de la chronique qu’il lui consacrait, en avril 2018, dans la revue Europe, Olivier Barbarant cite ce très beau poème d’Ales Steger, un poète slovène traduit par Guillaume Métayer et Mathias Rambaud (dans Le Livre des choses, paru aux éditions Circé).
Dans son propos liminaire, l’auteur des chroniques ici rassemblées note fort justement que, si la « surdité » à l’égard de la poésie est aujourd’hui « majoritaire », la vitalité de celle-ci est pourtant bien réelle, comme en témoigne notamment « la riche fabrique de traduction qui travaille en France, dans une indifférence sidérante ».
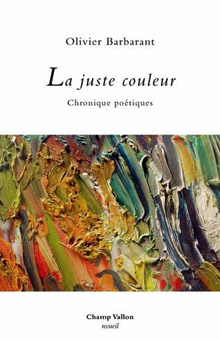 La dernière partie de ces chroniques, intitulée « À l’école des étrangers » est tout entière consacrée à des poètes traduits dans notre langue. Beaucoup sont connus (George Oppen, Ossip Mandelstam, Giorgio Caproni…), d’autres sont de vraies découvertes (pour moi en tout cas), comme le poète russe Sergueï Stratanovski.
La dernière partie de ces chroniques, intitulée « À l’école des étrangers » est tout entière consacrée à des poètes traduits dans notre langue. Beaucoup sont connus (George Oppen, Ossip Mandelstam, Giorgio Caproni…), d’autres sont de vraies découvertes (pour moi en tout cas), comme le poète russe Sergueï Stratanovski.Si Olivier Barbarant affirme que la « guerre des camps » propre à la poésie contemporaine ne l’intéresse pas, il attache par contre une grand importance à la transmission de la tradition. En témoigne le long et bel entretien accordé à Jean-Baptiste Para à propos de Racine, dont il ne craint pas de dire qu’il est « profondément actuel », quand bien même il est aujourd’hui « la victime d’un effet de ressac dans l’institution scolaire ».
On pourra évidemment discuter le choix des auteurs contemporains retenus par l’auteur pour ces chroniques. L’attention d’Olivier Barbarant à la poésie la plus contemporaine est cependant indéniable, comme en témoigne la chronique consacrée à une anthologie (« Génération poésie debout », aux éditions Le Temps des Cerises) où la plupart des poètes rassemblés ont à peine trente ans. Pour ceux-ci, note l’auteur, « le conflit entre formalisme et lyrisme paraît définitivement dépassé ». Non sans ajouter, à propos de la vogue des « performances », que « la poésie liée à la performance orale devra se méfier, si comme on peut le penser elle en vient à dominer le paysage, des facilités du spectacle, de l’abandon à ce qui peut frapper momentanément l’auditoire, comme de tout ce qu’une présence sur scène aveugle des faiblesses verbales et donc mentales du propos ».
► Laurent DEMANZE, Pierre Michon. L’Envers de l’histoire, José Corti, automne 2021, 250 pages, 21 €.
Pierre Michon est suffisamment lucide et habité par l’intranquillité (au sens de Pessoa et de son hétéronyme Bernardo Soares) pour ne se faire aucune illusion sur la catégorie de « Grantécrivain ».
hétéronyme Bernardo Soares) pour ne se faire aucune illusion sur la catégorie de « Grantécrivain ».
 hétéronyme Bernardo Soares) pour ne se faire aucune illusion sur la catégorie de « Grantécrivain ».
hétéronyme Bernardo Soares) pour ne se faire aucune illusion sur la catégorie de « Grantécrivain ».Il n’empêche que son œuvre est de tout premier ordre et largement reconnue comme telle.
Le grand mérite du livre que Laurent Demanze lui consacre, une étude aussi fouillée que magistrale, est de creuser du côté de l’essentiel, qu’il formule ainsi : « Je voudrais rendre à cette œuvre contemporaine sa force d’irruption et sa puissance d’événement. Au lieu de l’écrivain majuscule, entré de son vivant dans les histoires littéraires, travailler à déclassiciser Pierre Michon. Rappeler en somme la voix barbare qui gronde sous le style, la sauvagerie moderniste tapie sous le souci de réparer les vies ou la brutalité préhistorique sous l’ambition démocratique. »
► Denis MONTEBELLO, Beaudésir, Le Réalgar, coll. « Chemin des crêtes », hiver 2021-2022, 108 pages, 10 €.
Voilà maintenant plus de trente ans que je lis Denis MONTEBELLO. Gardant un fort souvenir, par exemple, de son beau roman Moi, Petturon, prince celte (1992). Un écrivain singulier et trop méconnu (malgré plus de 25 livres à son actif).
« Si le poète a quelque obligation envers la société, c’est celle de bien écrire », remarquait Joseph Brodsky. Mais il doit en même temps ne pas oublier qu’il est un obligé du monde, avec pour tâche de dire le beau désir du monde qui malgré tout nous reste.
Quand je lis Denis Montebello, c’est une musique bien à lui que j’entends. Celle d’un écrivain  qui jamais n’oublie d’écouter la langue – d’écouter par exemple l’étymologie du mot « s’évaltonner », un terme qui n’est plus guère en usage qu’en Lorraine. Qui écoute également la langue la plus contemporaine (« On ne traiterait plus un gamin de navet d’Archettes, ni de quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs, on le ‘traiterait’. Et si on devait ‘l’insulter de quelque chose, ce ne serait sûrement pas de navet d’Archettes. Qui ne dirait rien à personne. Qui serait quand même abuser. Traiter son fils de navet d’Archettes, ‘ça ne se fait pas’. ‘Trop pas’. ‘C’est grave chelou’ « .).
qui jamais n’oublie d’écouter la langue – d’écouter par exemple l’étymologie du mot « s’évaltonner », un terme qui n’est plus guère en usage qu’en Lorraine. Qui écoute également la langue la plus contemporaine (« On ne traiterait plus un gamin de navet d’Archettes, ni de quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs, on le ‘traiterait’. Et si on devait ‘l’insulter de quelque chose, ce ne serait sûrement pas de navet d’Archettes. Qui ne dirait rien à personne. Qui serait quand même abuser. Traiter son fils de navet d’Archettes, ‘ça ne se fait pas’. ‘Trop pas’. ‘C’est grave chelou’ « .).
 qui jamais n’oublie d’écouter la langue – d’écouter par exemple l’étymologie du mot « s’évaltonner », un terme qui n’est plus guère en usage qu’en Lorraine. Qui écoute également la langue la plus contemporaine (« On ne traiterait plus un gamin de navet d’Archettes, ni de quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs, on le ‘traiterait’. Et si on devait ‘l’insulter de quelque chose, ce ne serait sûrement pas de navet d’Archettes. Qui ne dirait rien à personne. Qui serait quand même abuser. Traiter son fils de navet d’Archettes, ‘ça ne se fait pas’. ‘Trop pas’. ‘C’est grave chelou’ « .).
qui jamais n’oublie d’écouter la langue – d’écouter par exemple l’étymologie du mot « s’évaltonner », un terme qui n’est plus guère en usage qu’en Lorraine. Qui écoute également la langue la plus contemporaine (« On ne traiterait plus un gamin de navet d’Archettes, ni de quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs, on le ‘traiterait’. Et si on devait ‘l’insulter de quelque chose, ce ne serait sûrement pas de navet d’Archettes. Qui ne dirait rien à personne. Qui serait quand même abuser. Traiter son fils de navet d’Archettes, ‘ça ne se fait pas’. ‘Trop pas’. ‘C’est grave chelou’ « .).Denis Montebello est avant tout un prosateur. Son phrasé cependant possède un truitage, un écoulement, sans cesse césuré de barrages, suscitant ainsi un rythme qui doit beaucoup au vers, à son art de la coupe. La narration, entre récit et réflexion, progresse ainsi au gré de rebonds et d’ellipses où discrètement résonne la charge poétique des mots.
Beaudésir rassemble des fragments où l’ « amor mundi », bien qu’il parle de territoires et pays précis, ne cède jamais à quelque nostalgie que ce soit d’un terroir. On est d’abord en Lorraine, à Epinal, la « Cité des images », mais bien vite on s’évade (« s’évaltonne ») vers la Charente ou plus encore l’Italie, dont est originaire le grand-père de l’auteur, une « maçon sans maisons ».
De biais, par petites touches, c’est un peu une autobiographie qui se dessine, mais elle est tout sauf autocentrée. Elle redonne vie, en même temps qu’à des lieux, à des figures oubliées : le peintre Monsu Desiderio (en réalité ils sont deux, sinon trois, sous ce pseudonyme), le polygraphe François-Didier D’Attel de Luttange (1787-18858) ou encore Pierre Véry (l’auteur de Goupi mains rouges). Une séquence magnifique évoque aussi le séjour de Nietzsche au lac d’Orta en compagnie de Paul Rée et de Lou Salomé.

![[Livres] Jean-Claude Pinson, Libr-kaléidoscope (2)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/12/band-kaleidoscopebis.jpg)