Judith Wiart, Pas d’équerre, Éditions Louise Bottu, automne 2023, 135 pages, 14 €, ISBN : 979-10-92723-64-9.
La question que pose d’emblée le très beau livre de Judith Wiart, dédié Aux élèves du lycée professionnel, est celle de son statut. Découpé selon une temporalité scolaire (Premier trimestre, Deuxième trimestre, Troisième trimestre), il pourrait s’agir d’une chronique de la vie d’un lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics de la banlieue lyonnaise, l’un de ces établissements qui scolarisent « un tiers de notre jeunesse », chronique rédigée par une enseignante de lettres/histoire dont les élèves sont, nolens volens, « en » CAP maçonnerie ou menuiserie et qui les observe au quotidien, cite leurs paroles, rapporte les dialogues auxquels la situation d’enseignement donne lieu. Il pourrait s’agir aussi d’un livre de combat, engagé « textes à l’appui » contre la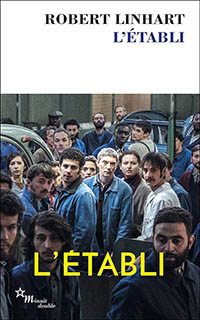 réforme du lycée professionnel qui change la finalité de l’école en réduisant drastiquement la place de la culture générale et en transformant l’élève en apprenti. Or, si l’on ne peut nier cette dimension, elle n’apparaît pas, lecture achevée, au cœur du projet.
réforme du lycée professionnel qui change la finalité de l’école en réduisant drastiquement la place de la culture générale et en transformant l’élève en apprenti. Or, si l’on ne peut nier cette dimension, elle n’apparaît pas, lecture achevée, au cœur du projet.
Chacun des genres évoqués, chronique ou pamphlet, a sa légitimité, dispose d’un corpus déjà copieux constitué, en gros, depuis les années 80, et même de ses lettres de noblesse, mais le lecteur prend très vite conscience que, plutôt qu’un n-ième livre sur les carences de l’institution et l’évocation des scènes pittoresques, drôles ou affligeantes dont cette dernière est par nature le théâtre, il a entre les mains un texte d’une toute autre force et qui m’a souvent fait penser, dans un contexte différent, à L’Établi de Robert Linhart.
Cette force est liée au montage de textes issus de champs différents et dont la mise en relation produit un effet de non-orthogonalité (« pas d’équerre ») proprement poétique. Le champ du témoignage, d’abord, celui d’une professeure qui assiste à la mise en scène de corps adolescents dans les lieux de la contrainte scolaire :
Dans la cour, dans les couloirs, les garçons se donnent des coups de poing, s’étranglent, se battent et, s’ils finissent par s’enlacer, c’est à l’image de ces boxeurs qui reprennent leur souffle avant le retour au combat.
(…)
Comment Bryan tient-il sur une chaise ? Son avachissement est une curiosité sans cesse renouvelée, son corps élastique un mystère formidable. Le buste n’est pas seulement relâché, il coule littéralement sous la table, s’étale, se répand, s’allonge, comme désossé. Chat sans vertèbre.
Celui de la « matière administrative », ensuite. Des extraits du texte de loi de 2019, du projet de réforme de 2023, sont introduits comme des éléments constitutifs de la narration, à même hauteur que les autres, sans privilège ni mépris. Cette « littérature grise » est parfois citée sous la forme médiatisée du commentaire qui en est fait par le site Le café pédagogique. On peut le regretter, car ce choix produit involontairement un jugement de valeur qui aurait gagné à être laissé au lecteur, et une forme d’« indignation », qui n’est pas, on le verra, contrairement aux apparences, le mode principal sur lequel le livre est construit.
En effet, l’essentiel réside ici dans l’écoute de la parole des élèves et dans la transcription de leur production écrite, élaborée en classe ou à l’occasion « d’ateliers d’écriture avec le poète Patrick Laupin entre 2011 et 2019 ».
♦♦♦♦♦
Les paroles rapportées sont celles d’adolescents qui ont parfois vécu des situations terrifiantes et connaissent une vie difficile, marquée par la fatigue. Cela les rapproche des ouvriers de Robert Linhart. Comme ces derniers, ils sont capables de fulgurances verbales :
L’élève afghan dit : « Chez nous, tout le monde écrit de la poésie. Les riches et les pauvres. Chez nous, on est tous poètes. »
Vous pouvez repasser, s’il vous plait ? On est en train d’écrire.
Les productions écrites sont au centre du livre et Judith Wiart ne cache pas son émotion devant certaines d’entre elles :
 Elle a 16 ans, vient du Soudan, vit en France depuis deux ans. Sa maîtrise du français est encore approximative et pourtant, je découvre un texte comme je n’en ai pas lu depuis longtemps. Je ne parle pas de textes découverts en classe, écrits par d’autres élèves, non, je parle de littérature en général. Elle utilise des mots simples, ceux qu’elle connaît en français, des tournures syntaxiques bancales, peu de ponctuation, mais son regard est celui d’une auteure, d’une poète, je le sais dès la deuxième ligne.
Elle a 16 ans, vient du Soudan, vit en France depuis deux ans. Sa maîtrise du français est encore approximative et pourtant, je découvre un texte comme je n’en ai pas lu depuis longtemps. Je ne parle pas de textes découverts en classe, écrits par d’autres élèves, non, je parle de littérature en général. Elle utilise des mots simples, ceux qu’elle connaît en français, des tournures syntaxiques bancales, peu de ponctuation, mais son regard est celui d’une auteure, d’une poète, je le sais dès la deuxième ligne.
Nadir « a le sens des mots », Faïssoil écrit un roman, Mohamed récite des années après des vers de Mahmoud Darwich appris à l’occasion d’une sortie au Théâtre de la Croix-Rousse des années auparavant, Damien et Habil citent La Fontaine, Malik a retenu Montaigne : « La mort, dit-on, nous acquitte de toutes nos obligations. » Nadir encore : « C’est moi qui ai écrit ça ? »
Sans dissimuler les aspects « insupportables, usants, tyranniques » des élèves, leur machisme, leur violence, le livre met l’accent sur la « voix intérieure » à laquelle ils accèdent parfois :
Aujourd’hui j’évade
Je me sens monotone
Mauvais moi mauvais geste
J’esquive tout
J’espère que mes erreurs seront effacées
Comme sur une ardoise à craie
Je prends tout
Je laisse pas de miettes
En regard de ce texte de Nadir M., CAP maçonnerie 2017, qui pourrait être écrit par l’un des poètes « reconnus » chroniqués sur un site comme celui-ci, l’auteure, dans l’une des parties les plus fortes de son livre, cite un « manuel scolaire de français pour le nouveau programme de CAP 2019 » qui s’ouvre sur un « poème » dont l’exégèse est proposée aux candidats à cet examen. Écrit par « un poète et écrivain français que ses études d’ingénieur ne détournent pas de son amour des arts », le voici, dans le corps typographique qu’il mérite :
Elle a des yeux océans [sic]
Où l’on plonge dedans
Et des cheveux soyeux
Couleur soleil radieux
Un teint évoquant
De doux nuages blancs
Et tel un don des cieux
Un corps merveilleux.
Judith Wiart, dans les dernières pages de son livre, affirme d’une manière absolue son rejet de toute forme d’indignation surjouée (« la chose la plus aisée et la plus répandue au monde. Beaucoup de bruit suivi souvent de beaucoup de rien »). A contrario, la simple juxtaposition d’une telle mirlitonnade, présentée par des auteurs de manuels comme de la poésie, et des textes à haute intensité poétique produits par ses élèves migrants apparaît en soi comme un acte de protestation d’une redoutable efficacité contre le gâchis que constitue la négation de l’intelligence de toute une classe, sociale et d’âge. La poésie est fondamentalement rupture avec le français dit « fonctionnel » assigné aux représentants de cette classe et ce livre puissant est, à sa manière, un appel poétique « aux armes etc. » pour éviter la « grande catastrophe / Du trop tard ».
Le finale, avec l’évocation de la sonate en la majeur de Schubert, donne la mesure de l’équivalent musical de ces voix que nous avons entendues.
![[Chronique] François Crosnier, Paroles poétiques échappées du Lycée professionnel (à propos de Judith Wiart, Pas d'équerre)](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/06/Wiart_Equerre_BackG.jpg)

![[Chronique] François Crosnier, Paroles poétiques échappées du Lycée professionnel (à propos de Judith Wiart, Pas d’équerre)](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/06/band-Wiart.jpg)