Suite à la parution en décembre dernier de Polyphonie Penthésilée (P.O.L, 144 pages), mais également, en ce début janvier  2022, d’une anthologie proposée par Marie de Quatrebarbes aux éditions du Corridor bleu, Madame tout le monde, ce dossier qui emprunte son titre à l’une des sections de Polyphonie Penthésilée pour réunir entretiens, extraits (inédits pour la plupart) et chroniques, vise à donner un aperçu complémentaire de la création actuelle au féminin, tout en donnant la parole à des poétesses sur leurs pratiques comme sur les conditions qui leur sont faites dans cet espace éditorial de circulation restreinte : environ deux tiers d’entre elles (61,5% exactement) ont participé à l’une ou l’autre de ces deux aventures collectives cruciales que sont Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021) et Madame tout le monde ; ajoutons deux autres variables, l’âge (pour l’instant : une septuagénaire, une sexagénaire, une quinquagénaire, six quadragénaires et quatre trentenaires) et les lieux d’édition (une petite trentaine). Les trois mêmes questions sont posées à chacune afin de construire un éventail de réponses qui, à défaut de constituer une enquête conforme à tous les critères propres aux sciences sociales, n’en est pas moins significative.
2022, d’une anthologie proposée par Marie de Quatrebarbes aux éditions du Corridor bleu, Madame tout le monde, ce dossier qui emprunte son titre à l’une des sections de Polyphonie Penthésilée pour réunir entretiens, extraits (inédits pour la plupart) et chroniques, vise à donner un aperçu complémentaire de la création actuelle au féminin, tout en donnant la parole à des poétesses sur leurs pratiques comme sur les conditions qui leur sont faites dans cet espace éditorial de circulation restreinte : environ deux tiers d’entre elles (61,5% exactement) ont participé à l’une ou l’autre de ces deux aventures collectives cruciales que sont Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021) et Madame tout le monde ; ajoutons deux autres variables, l’âge (pour l’instant : une septuagénaire, une sexagénaire, une quinquagénaire, six quadragénaires et quatre trentenaires) et les lieux d’édition (une petite trentaine). Les trois mêmes questions sont posées à chacune afin de construire un éventail de réponses qui, à défaut de constituer une enquête conforme à tous les critères propres aux sciences sociales, n’en est pas moins significative.
Après l’entretien de Liliane Giraudon, de Sandra MOUSSEMPÈS, d’Aurélie Olivier, qui a dirigé le volume Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021), de Virginie Lalucq, d’Elsa Boyer, de A.C. Hello, de Marina SKALOVA, voici celui de Laure Gauthier.
Laure Gauthier est une écrivaine et poétesse qui vit et écrit à Paris. Elle conçoit ses textes comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois la place de la sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde ultra-rationalisé, et la place du document et de l’archive dans l’expérience de la violence individuelle et politique. Elle a récemment publié Kaspar de pierre (La Lettre volée, 2017), je neige (entre les mots de villon) (LansKine, 2018), Les Corps caverneux (LansKine 2022) et l’essai D’un lyrisme l’autre (MF 2022). En mars 2023, reparaît La Cité dolente chez LansKine.
comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois la place de la sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde ultra-rationalisé, et la place du document et de l’archive dans l’expérience de la violence individuelle et politique. Elle a récemment publié Kaspar de pierre (La Lettre volée, 2017), je neige (entre les mots de villon) (LansKine, 2018), Les Corps caverneux (LansKine 2022) et l’essai D’un lyrisme l’autre (MF 2022). En mars 2023, reparaît La Cité dolente chez LansKine.
En ce temps de chasse au « wokisme », comment traiter encore les rapports de domination ? Sans tomber dans l’idéologie et en maintenant le cap : LIBR-CRITIQUE s’est toujours inscrite dans le prolongement de la pensée critique des Modernes, ce qui suppose le refus de tout identitarisme. Dans Soi-même comme un roi. Essai sur les dérives identitaires(Seuil, 2021), Élisabeth Roudinesco montre lumineusement en quoi diffèrent les luttes émancipatrices du siècle dernier et celles menées actuellement au nom de telle ou telle soi-disant « identité » (raciale, nationale ou sexuelle) : les premières visent un universel singulier (Sartre) ; les secondes, un particularisme sectaire. /FT/
Entretien de Laure Gauthier avec Fabrice Thumerel
FT. Aujourd’hui, que font les femmes à la poésie ?
LG. Il m’est très difficile de répondre à une question aussi vaste et complexe. Je vais n’aborder que certains aspects. En partant de biais. Chaque poète, quel que soit son genre, homme, femme, trans- ou intergenre, crée une œuvre singulière qui fait quelque chose à la poésie, nécessairement. Par ailleurs, il y a toujours l’inscription dans une conjoncture « générale », historique, politique et culturelle, et la nôtre est non seulement celle de la société libérale, mais aussi, ce qui est plus heureux, celle de l’effondrement progressif du modèle patriarcal qui touche toutes les sphères de la société, de la pensée et bien évidemment la vie artistique qui n’est pas coupée du monde dans lequel elle s’inscrit. Il faut donc prendre acte d’une part de la singularité, ne pas mettre dans un même sac toutes les femmes poètes, ce qu’on ne fait pas avec les hommes poètes, et d’autre part d’un mouvement collectif qui cherche à inventer un nouveau modèle de pensée et de société post-patriarcal. Et ce mouvement marque aussi le champ de l’écriture.
Depuis une dizaine d’années en France se produit un grand et large mouvement émancipateur, une (r)évolution des pratiques, des écritures, des collaborations, de la pensée critique en même temps que la question du genre et la place de la femme évoluent dans la société. Certes, cela fait un siècle que le mur de l’invisibilisation des femmes artistes commence à vaciller, mais là il s’effondre enfin dans ses fondements, et on commence à apercevoir la possibilité d’une vie sans ce mur. Evidemment certain.e.s le vivent comme une guerre des sexes, mais cela va pourtant vers l’idée d’une égalité possible, pratiquée. La guerre s’adresse aux pans du mur encore debout, à des mécanismes de pouvoir. Alors comme dans toute forme de « révolution », cela libère à la fois des excès certes, mais aussi le plus souvent des énergies créatrices particulières, des intensités et des points de vue qui émergent, un renouveau qui va se construire avec le 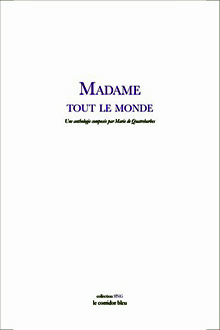 temps. J’apprécie le point de vue de Marie de Quatrebarbes qui, dans son anthologie Madame tout le monde, à laquelle je suis heureuse d’avoir participé, donne à voir des constellations, des projets collectifs variés émanant d’autrices aujourd’hui qui représentent de multiples versants de la création poétique : elle donne ainsi une idée, un survol de cette diversité créative, montre les projets dans leur singularité tout en rendant compte de la poussée collective. La concomitance des deux domaines est importante. La misogynie comme le racisme fonctionne par amalgames, en essentialisant, en généralisant, donc il est nécessaire de montrer combien sont nombreuses les autrices, combien elles existent collectivement, et en même temps combien leur champ d’action, de pensée et d’écriture est varié et étendu, d’une singularité non assignable. Par ailleurs, cette anthologie donne un exemple de solidarité à l’œuvre, en illustrant des collaborations entre écrivaines, alors que le patriarcat profitait de la division et de la concurrence entre femmes. C’est également en ce sens que va l’action de Chloé Delaume, par exemple dans l’organisation de ses Petites veillées chez Mona à Paris où elle présente des autrices confirmées ou débutantes, celle aussi des Parleuses qui propage les livres et les voix d’autrices ou encore celle de nouvelles revues comme celle de Lénaig Cariou qui, dans Point de chute, accueille des écrivaines débutantes dont on sait que, longtemps, elles se sont censurées.
temps. J’apprécie le point de vue de Marie de Quatrebarbes qui, dans son anthologie Madame tout le monde, à laquelle je suis heureuse d’avoir participé, donne à voir des constellations, des projets collectifs variés émanant d’autrices aujourd’hui qui représentent de multiples versants de la création poétique : elle donne ainsi une idée, un survol de cette diversité créative, montre les projets dans leur singularité tout en rendant compte de la poussée collective. La concomitance des deux domaines est importante. La misogynie comme le racisme fonctionne par amalgames, en essentialisant, en généralisant, donc il est nécessaire de montrer combien sont nombreuses les autrices, combien elles existent collectivement, et en même temps combien leur champ d’action, de pensée et d’écriture est varié et étendu, d’une singularité non assignable. Par ailleurs, cette anthologie donne un exemple de solidarité à l’œuvre, en illustrant des collaborations entre écrivaines, alors que le patriarcat profitait de la division et de la concurrence entre femmes. C’est également en ce sens que va l’action de Chloé Delaume, par exemple dans l’organisation de ses Petites veillées chez Mona à Paris où elle présente des autrices confirmées ou débutantes, celle aussi des Parleuses qui propage les livres et les voix d’autrices ou encore celle de nouvelles revues comme celle de Lénaig Cariou qui, dans Point de chute, accueille des écrivaines débutantes dont on sait que, longtemps, elles se sont censurées.
Et cette émergence-là, j’entends dans cette intensité-là, a bien lieu depuis une dizaine d’années. Bien sûr, il y avait des femmes poètes, des femmes performeuses, des femmes traductrices, des femmes éditrices de poésie, des femmes critiques littéraires. Mais ce qui est nouveau, c’est que d’année en année, elles sont de plus en plus nombreuses dans la poésie à tous les étages : poètes mais aussi directrices de maison de poésie, de section du CNL, programmatrices de festival, critiques, traductrices, éditrices. Par ailleurs, il y a chez la plupart des poètes femmes mais aussi chez de plus en plus d’hommes en poésie, un engagement, la conscience de devoir participer à ce mouvement de dés-invisibilisation, de prise au sérieux de l’écriture, de la voix et de la pensée de femmes poètes en traduisant, en rééditant des œuvres passées sous silence, en invitant enfin les femmes à débattre de questions poétologiques, politiques, écopoétiques et philosophiques. Ne pas limiter la poésie écrite par des femmes à des questions relevant des femmes, même si elles sont nécessaires également, mais entendre la portée générale des livres et des voix. Tu vois, tu fais cet entretien, et autour de moi de nombreux hommes, loin d’être effrayés par cette coupe nette avec des siècles d’exclusion des artistes femmes, souhaitent aussi vivre par-delà ces frontières de genres et participer à ce mouvement. Pour répondre enfin à la question de façon plus directe : Que font les femmes à la poésie ? La même chose que les hommes, mais justement, c’est là que le bât a blessé, c’est cela qui était empêché. De pouvoir agir à tous les niveaux : écrire, penser, initier des projets collectifs et continuer chacune notre travail et qu’il soit perçu avec la même force, avec le même sérieux que le travail des poètes hommes, qu’il soit autant l’objet de débats, de réflexions, d’échanges, même de critiques. Que ce qui se passe dans un vers, dans une page, un récit ou une performance soit reçu avec la même intensité que ce soit dans l’approbation ou le rejet. Pris au sérieux donc et non pas mis de côté ou « anodinisé ». Cela évolue chaque jour en ce sens et je m’en félicite. Et un jour, cela sera une évidence. Et nous n’aurons plus à répondre à cette question.
mais aussi directrices de maison de poésie, de section du CNL, programmatrices de festival, critiques, traductrices, éditrices. Par ailleurs, il y a chez la plupart des poètes femmes mais aussi chez de plus en plus d’hommes en poésie, un engagement, la conscience de devoir participer à ce mouvement de dés-invisibilisation, de prise au sérieux de l’écriture, de la voix et de la pensée de femmes poètes en traduisant, en rééditant des œuvres passées sous silence, en invitant enfin les femmes à débattre de questions poétologiques, politiques, écopoétiques et philosophiques. Ne pas limiter la poésie écrite par des femmes à des questions relevant des femmes, même si elles sont nécessaires également, mais entendre la portée générale des livres et des voix. Tu vois, tu fais cet entretien, et autour de moi de nombreux hommes, loin d’être effrayés par cette coupe nette avec des siècles d’exclusion des artistes femmes, souhaitent aussi vivre par-delà ces frontières de genres et participer à ce mouvement. Pour répondre enfin à la question de façon plus directe : Que font les femmes à la poésie ? La même chose que les hommes, mais justement, c’est là que le bât a blessé, c’est cela qui était empêché. De pouvoir agir à tous les niveaux : écrire, penser, initier des projets collectifs et continuer chacune notre travail et qu’il soit perçu avec la même force, avec le même sérieux que le travail des poètes hommes, qu’il soit autant l’objet de débats, de réflexions, d’échanges, même de critiques. Que ce qui se passe dans un vers, dans une page, un récit ou une performance soit reçu avec la même intensité que ce soit dans l’approbation ou le rejet. Pris au sérieux donc et non pas mis de côté ou « anodinisé ». Cela évolue chaque jour en ce sens et je m’en félicite. Et un jour, cela sera une évidence. Et nous n’aurons plus à répondre à cette question.
FT. Remise en question, la domination masculine est encore d’actualité dans le milieu poétique. Est-ce à dire qu’un #MeToo y serait également nécessaire ?
LG. Jusqu’à très récemment des pratiques violentes (abus, harcèlement ou viol appelés, ce qui en dit long, « droit de cuissage », etc.) se perpétraient encore de façon trop fréquente partout où des hommes tenaient le pouvoir artistique de façon exclusive, et notamment là où le pouvoir symbolique était associé à un pouvoir lucratif : le cinéma, la danse, la télévision, le sport, là où la possibilité d’une carrière pouvait échouer si on ne sacrifiait pas son corps au désir de l’autre au pouvoir. Bien sûr, ça ne résume pas tout et ne doit pas porter à des amalgames ni à des généralisations, car fort heureusement bien d’autres agissaient autrement. Et il ne s’agit pas d’essentialiser le débat mais de dénoncer des pratiques de pouvoir et d’une culture, celle du patriarcat. Mais dans certains milieux, notamment au cinéma, cela a été un système et tout le monde laissait faire. Le monde de la poésie n’est pas structuré autour d’institutions ou de lieux de pouvoir et d’argent. La violence n’a donc pas été la même, elle n’a pas cette organisation institutionnelle et relève, je pense, plus d’abus individuels. En revanche, on peut se féliciter que ces questions soulevées par #MeToo interrogent tous les comportements d’abus de pouvoir, ou de comportements pervers et destructeurs aussi dans la poésie.
Par ailleurs, des femmes de toutes les couches sociales et aussi des poétesses connaissent des violences conjugales, et certaines femmes voient leur œuvre détruite, je pense à la notion d’« articide » et au collectif fondé par la poétesse Aurélie Foglia qui a subi la destruction complète de son œuvre plastique sans qu’il n’y ait eu de réactions publiques dans le monde de la poésie. De mon côté, c’est à l’université, pendant mes études, et, ensuite, dans le monde de la radio que j’ai vécu des pratiques harcelantes ou des chantages. A l’époque, c’était l’omerta.
violences conjugales, et certaines femmes voient leur œuvre détruite, je pense à la notion d’« articide » et au collectif fondé par la poétesse Aurélie Foglia qui a subi la destruction complète de son œuvre plastique sans qu’il n’y ait eu de réactions publiques dans le monde de la poésie. De mon côté, c’est à l’université, pendant mes études, et, ensuite, dans le monde de la radio que j’ai vécu des pratiques harcelantes ou des chantages. A l’époque, c’était l’omerta.

Ce dont on peut se réjouir, c’est qu’il y a depuis #MeToo un refus du patriarcat beaucoup plus net chez les jeunes autrices, aussi une solidarité nouvelle et une entraide quand quelqu’un est victime de harcèlement et de violence. Il y a également un mouvement chez de nombreux poètes hommes qui se sont construits ou se construisent en refusant cette part de pouvoir en eux et sont solidaires de cette émancipation et pour la nouvelle génération d’artistes, les choses sont beaucoup plus espérantes. Je sais que j’échange beaucoup à ce sujet avec des poètes de différentes générations qui vont dans ce sens.
Dans les années 1990 et au début des années 2000, je vivais en partie en Allemagne, à Hambourg, et j’ai été consternée de voir la différence entre la France et l’Allemagne quant à l’importance accordée aux écrivaines et aux poétesses. En France, peu de femmes étaient publiées dans ce que l’on appelle les « grandes revues », souvent une par numéro, et peu dans les « grandes maisons » d’édition ; j’étais stupéfaite de voir combien elles étaient éclipsées des débats dès lors que l’on touchait à la pensée, à la portée philosophique ou politique de la poésie. Parfois une femme était là, en bout de table. La même sidération me prenait quant à la place restreinte des poétesses dans les lectures publiques et / ou les performances. Bien sûr, on 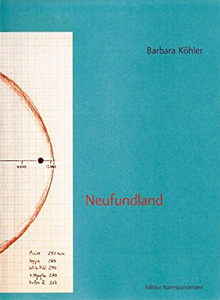 trouve toujours des exceptions à tous les siècles, des femmes qui ont réussi à la force du poignet à vivre leurs vies et leurs œuvres de poétesses, d’éditrices ou de critiques et heureusement il y en a qui ont tenu bon. Dans les autres pays, en Allemagne, en Suède, en Russie, aux Etats-Unis, ou encore en Angleterre, plus de femmes poètes ont été considérées et soutenues au XXe siècle qu’en France. Qu’on pense, pour les pays germanophones, à la reconnaissance de la poésie de Nelly Sachs, Rose Ausländer, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Elke Erb, Sarah Kirsch, Barbara Köhler, Brigitte Oleschinski, Anne Duden, Friederike Mayröcker, Helga Novak, Ulla Hahn et tant d’autres, dont l’œuvre est reçue au plus haut point. La France a vraiment maltraité ses autrices plus que d’autres pays occidentaux. Mais, au fil des années, le nombre de femmes publiées et prises au sérieux a augmenté, on le voit par exemple dans l’anthologie Flammarion, chaque année elles sont un peu plus nombreuses. Mais les débats, les revues, le monde des festivals, des musées, des critiques, des maisons de la poésie, tout ou presque était quasi exclusivement masculin. Par ailleurs, les œuvres de femmes étaient moins débattues, moins considérées. On me dira peut-être que je dévie de passer du harcèlement sexuel à la déconsidération poétique et poétologique, mais non : il y a un lien entre le harcèlement du corps et la déconsidération de l’œuvre, la déconsidération de la femme comme à même de construire une œuvre et de renouveler l’écriture poétique comme la pensée du poème. C’est la déconsidération de l’autre. Dans les années 1990-2000, j’ai noté les sujets de thèse donnés à l’université française sur la poésie, qu’elle soit écrite ou sonore, et en dix ans, je n’ai pas entendu un seul nom de femme proposé. Il a dû y en avoir, mais la recherche portait très majoritairement sur l’œuvre d’hommes, une chose impensable dans d’autres pays européens. Heureusement, cela a évolué depuis 2000 et encore davantage depuis une dizaine d’années, grâce à l’implication il faut le dire à la fois de chercheurs et de chercheuses. Tout cela est bon signe.
trouve toujours des exceptions à tous les siècles, des femmes qui ont réussi à la force du poignet à vivre leurs vies et leurs œuvres de poétesses, d’éditrices ou de critiques et heureusement il y en a qui ont tenu bon. Dans les autres pays, en Allemagne, en Suède, en Russie, aux Etats-Unis, ou encore en Angleterre, plus de femmes poètes ont été considérées et soutenues au XXe siècle qu’en France. Qu’on pense, pour les pays germanophones, à la reconnaissance de la poésie de Nelly Sachs, Rose Ausländer, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Elke Erb, Sarah Kirsch, Barbara Köhler, Brigitte Oleschinski, Anne Duden, Friederike Mayröcker, Helga Novak, Ulla Hahn et tant d’autres, dont l’œuvre est reçue au plus haut point. La France a vraiment maltraité ses autrices plus que d’autres pays occidentaux. Mais, au fil des années, le nombre de femmes publiées et prises au sérieux a augmenté, on le voit par exemple dans l’anthologie Flammarion, chaque année elles sont un peu plus nombreuses. Mais les débats, les revues, le monde des festivals, des musées, des critiques, des maisons de la poésie, tout ou presque était quasi exclusivement masculin. Par ailleurs, les œuvres de femmes étaient moins débattues, moins considérées. On me dira peut-être que je dévie de passer du harcèlement sexuel à la déconsidération poétique et poétologique, mais non : il y a un lien entre le harcèlement du corps et la déconsidération de l’œuvre, la déconsidération de la femme comme à même de construire une œuvre et de renouveler l’écriture poétique comme la pensée du poème. C’est la déconsidération de l’autre. Dans les années 1990-2000, j’ai noté les sujets de thèse donnés à l’université française sur la poésie, qu’elle soit écrite ou sonore, et en dix ans, je n’ai pas entendu un seul nom de femme proposé. Il a dû y en avoir, mais la recherche portait très majoritairement sur l’œuvre d’hommes, une chose impensable dans d’autres pays européens. Heureusement, cela a évolué depuis 2000 et encore davantage depuis une dizaine d’années, grâce à l’implication il faut le dire à la fois de chercheurs et de chercheuses. Tout cela est bon signe.
C’est cet a priori contre lequel on est très démuni car il relève d’un système de pensée, et qu’il a été le système de toute une société considérée comme « éclairée ». Le corps malade évoqué dans les livres de femmes n’était pas considéré comme autant politique que le corps masculin, de même, la pensée poétologique à l’œuvre chez les femmes a été moins considérée ou débattue  que chez les équivalents masculins, le corps sexuel ou la réflexion sur la vie ou la mort était envisagé de façon plus particulariste chez les écrivaines que chez Bataille ou d’autres auteurs. Un jeune éditeur un jour me dit « les femmes ont du talent, mais pas de génie ». C’était en 2015 en France ! Quelle violence. Par ailleurs, jamais dans mes études de la 6e à mon agrégation, en passant par les séminaires de master ou de doctorat dans les années 2000, on ne nous a proposé au programme d’étudier une œuvre de femme. Un enseignant nous a donné un jour un texte de Duras à traduire en nous disant, ravi : « elle écrit comme un homme », ce qui voulait dire qu’elle écrit bien. Violence ordinaire. Heureusement, depuis les années 2000, les choses ont évolué. Les filiations revendiquées en France étaient systématiquement masculines, tandis qu’ailleurs en Italie, en Angleterre, en Espagne ou en Italie et dans d’autres pays, j’étais surprise de voir des poètes revendiquer des filiations poétiques avec des écrivaines. C’est bien pour cela que les Anthologies Lettres à une jeune poétesse tout comme Madame tout le monde ont toute leur place, pour donner enfin le sentiment à la génération des jeunes autrices à venir qu’elles sont légitimes et attendues.
que chez les équivalents masculins, le corps sexuel ou la réflexion sur la vie ou la mort était envisagé de façon plus particulariste chez les écrivaines que chez Bataille ou d’autres auteurs. Un jeune éditeur un jour me dit « les femmes ont du talent, mais pas de génie ». C’était en 2015 en France ! Quelle violence. Par ailleurs, jamais dans mes études de la 6e à mon agrégation, en passant par les séminaires de master ou de doctorat dans les années 2000, on ne nous a proposé au programme d’étudier une œuvre de femme. Un enseignant nous a donné un jour un texte de Duras à traduire en nous disant, ravi : « elle écrit comme un homme », ce qui voulait dire qu’elle écrit bien. Violence ordinaire. Heureusement, depuis les années 2000, les choses ont évolué. Les filiations revendiquées en France étaient systématiquement masculines, tandis qu’ailleurs en Italie, en Angleterre, en Espagne ou en Italie et dans d’autres pays, j’étais surprise de voir des poètes revendiquer des filiations poétiques avec des écrivaines. C’est bien pour cela que les Anthologies Lettres à une jeune poétesse tout comme Madame tout le monde ont toute leur place, pour donner enfin le sentiment à la génération des jeunes autrices à venir qu’elles sont légitimes et attendues.
Tout n’est pas encore égalitaire, mais ce moule-là est cassé. Alors il faut se réjouir de contribuer à imaginer d’autres horizons, ensemble. Les choses vont vite et il est bien qu’on travaille ensemble par-delà son genre. J’ai l’impression que la page se tourne progressivement, même si bien sûr il faut de la vigilance encore. Il est important à la fois que les femmes développent des projets ensemble pour sortir d’une mise en concurrence qui était la marque de fabrique du patriarcat, et que des hommes poètes accompagnent et soutiennent ces transformations : l’anthologie de Marie de Quatrebarbe est publiée par Pierre Vinclair au Corridor bleu, toi-même inities cette série d’entretiens, mais on ne compte plus, et fort heureusement, l’implication de médias, de directions de résidence ou de festivals, du Marché de la poésie, d’éditeurs, de directeurs de revue, de critiques et bien évidemment de poètes qui pratiquent au quotidien, parfois depuis bien longtemps, cette égalité et y déploient une énergie incroyable.
FT. En fin de compte, bien qu’il n’y ait pas d’écriture féminine (à bas l’essentialisme !), en quoi peut consister cette « langue / introuvable » qui serait celle des femmes selon Liliane Giraudon ?
LG. C’est une question infiniment complexe et là encore je ne peux qu’avancer certaines hypothèses sans pouvoir prétendre y répondre. Poser des questions à mon tour. Si l’on dit écriture, parle-t-on strictement de la langue, et non de ce qu’elle soulève, non des motifs qui la traversent ? En effet, dans beaucoup de livres de poésie, on trouve des éléments qui peuvent être liés à l’expression de mouvements de corps, de pensée ou de vie où le genre est en avant, où même il est revendiqué comme un avant-poste d’écriture et de pensée. Là, bien sûr, on devine le genre car il est au centre du projet d’écrire.

Installation sonore de T. Saraceno (décembre 2018)
Mais le plus souvent, si l’on s’en tient, comme tu dis, à l’écriture, je ne pense pas qu’on puisse reconnaître, en tous les cas, pas facilement, le genre d’une personne. Quand je lis un livre de poésie, écrit par une femme ou un homme, je n’y cherche pas une langue commune, mais un cosmos, forcément singulier, qui se déploie. Mais en même temps, la langue toute singulière qu’elle soit, est tourmentée, animée, nourrie, éclairée, traversée par des phénomènes, des questions, des conflits sociaux et collectifs : nous sommes tous, toutes lavés par une époque et par nos vies, mais nous sommes par ailleurs aussi dans la continuité voulue ou non, revendiquée ou rejetée, de questions du passé qui reviennent, qu’on reformule et qu’on propose en essayant d’imaginer un avenir autre. On trouve toujours dans la langue des irisations de l’époque, des alluvions, des éléments qui nous hantent et aussi des attaques qu’on traverse, et si on analyse finement la syntaxe, la ponctuation, les verbes, le rythme du vers, les césures, les blancs ou les blocs de prose, la fluidité du récit ou son arrêt, les images, la métaphorisation ou son rejet, on peut toujours déceler quelque chose relevant de l’inscription de l’auteur ou de l’autrice dans son époque. Sans parler de ce que dit le poème ou le récit. C’est toujours plus simple rétrospectivement de voir certains traits de langue communs à une génération, je pense par exemple à la génération romantique autour de 1800, à celle des premières avant-gardes autour de 1914, à celle qui a œuvré au moment de l’Après-Catastrophe ou encore à la mienne et à celle d’après, traversées par un capitalisme sauvage, une crise écologique et politique majeure et une redéfinition du genre.
Hélène Cixous affirme qu’écrire n’est jamais neutre. Du point de vue du genre. Mais cette question est complexe. Alors où cela se situe-t-il ? Il me semble que la question est plus vaste encore que celle du genre, il me semble que ce sont certaines « cultures » ou certaines « assignations » que l’on retrouve toujours dans l’écriture sous une forme revendiquée ou cachée, consciente ou inconsciente, ou plutôt certaines luttes contre ses assignations, certains mouvements contre ces cultures majoritaires ou dominatrices qui vont toucher à une époque donnée davantage un groupe de la population, notamment des groupes stigmatisés par la norme sociale.
Et pourtant, cela ne dit pas tout. La langue elle-même peut être neutre, par-delà masculin et féminin, sans assignation de genre, c’est ce que j’éprouve le plus souvent. Ainsi, Inès de la Cruz est marquée par les questions poétologiques de son siècle, le cadre de la société catholique au sein de laquelle elle évolue, mais peut-on deviner à son écriture qu’elle est une femme ? Je ne crois pas. Je pense la même chose de la langue de Clarice Lispector ou de Gertrud Stein. Pourrait-on deviner en lisant par exemple Marie de Quatrebarbe ou Lucie Taïeb que ce sont des autrices ? Je ne crois pas.
Certaines autrices, au contraire, ont développé une écriture qui pose l’idée d’une « culture féminine » ; or celle-ci longtemps était marquée par la fragilisation et le corps invisibilisé, et donc une évocation de la transparence. Ces textes « jouent » sur cette assignation pour dés-assigner la langue. Pensons à la poétesse allemande Barbara Köhler et à sa complexe réflexion sur le sujet féminin et son invisibilisation grammaticale. Mais c’est un élément dans une poétique complexe qui comporte plusieurs centres et décentrements. Par ailleurs, si, à un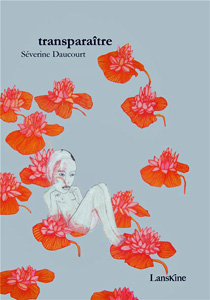 moment, on a trouvé, du fait de l’absence de pouvoir et de vie publique de la plupart des femmes qui écrivaient, un retravail dans l’expression poétique de la faille, de la transparence, du corps menacé, il en reste des traces dans la langue, forcément. Des traces de cet effacement où des violences sur le corps, sur l’exposition qui reste. Je pense aujourd’hui à des titres comme Transparaître (LansKine, 2019) de Séverine Daucourt ou à Comment dépeindre ? (Corti, 2020) d’Aurélie Foglia. Et ce travail de langue-là, qui prend à bras le corps de la langue l’invisibilisation par les hommes, la tentative d’effacement à la fois du corps et de l’œuvre, est particulièrement présent chez de nombreuses autrices au XXIe siècle. On peut trouver dans la langue des poètes juifs en exil après 1933 comme dans la langue de poètes migrant.e.s ou racisé.e.s du commun quant à la menace, à l’effacement, mais ce « commun », cette présence de menaces, ne doit jamais bien sûr entraver la lecture de la singularité à l’œuvre.
moment, on a trouvé, du fait de l’absence de pouvoir et de vie publique de la plupart des femmes qui écrivaient, un retravail dans l’expression poétique de la faille, de la transparence, du corps menacé, il en reste des traces dans la langue, forcément. Des traces de cet effacement où des violences sur le corps, sur l’exposition qui reste. Je pense aujourd’hui à des titres comme Transparaître (LansKine, 2019) de Séverine Daucourt ou à Comment dépeindre ? (Corti, 2020) d’Aurélie Foglia. Et ce travail de langue-là, qui prend à bras le corps de la langue l’invisibilisation par les hommes, la tentative d’effacement à la fois du corps et de l’œuvre, est particulièrement présent chez de nombreuses autrices au XXIe siècle. On peut trouver dans la langue des poètes juifs en exil après 1933 comme dans la langue de poètes migrant.e.s ou racisé.e.s du commun quant à la menace, à l’effacement, mais ce « commun », cette présence de menaces, ne doit jamais bien sûr entraver la lecture de la singularité à l’œuvre.
Dans un même temps, parallèlement à ce travail sur l’effacement, on trouve aujourd’hui dans la langue l’énergie de la rébellion, du « plus jamais ça ! ». On trouve des langues puissantes dans les livres des poétesses, qui puisent dans l’énergie du corps, qui jouent sur le mouvement, des formes d’émergences nouvelles pour aller chercher la lumière ailleurs, autrement. Des langues puissantes comme on a peut-être pu en trouver dans une jeune génération en Allemagne à l’époque du Sturm-und-Drang, des écritures qui se libèrent alors de la génération des « pères », cela rappelle au cinéma les débuts de la Nouvelle Vague : c’est une forme d’urgence à prendre part à la poésie, à mettre par-dessus bord un certain nombre de spectres, une urgence qui peut aussi être joyeuse et débordante, une nécessité à prendre le virage au sérieux et se dire qu’il faut 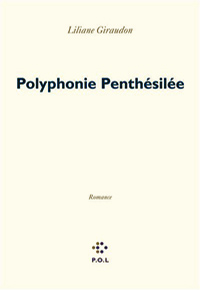 reposer toutes les questions, une fois que l’on s’est libéré de certains jougs : il y a récemment le Polyphonie Penthésilée de Liliane Giraudon, le Dehors dehors d’Anna Serra et tant d’autres, je ne veux pas dresser de liste. Cette énergie, cette force-fragilité, cette langue tout à la fois défective et guerrière, en tension permanente, est peut-être une langue qui caractérise plus encore certaines femmes poètes qui ont l’énergie des anciens parias comme l’ont été certains hommes bien sûr, comme l’a été Villon, comme l’ont été des hommes dans des situations d’effacement ou de fragilité, Kafka ou Nerval, on pense aujourd’hui à Dominique Quélen ou Christophe Manon et d’autres encore. Mais je me garderai de prétendre faire le tour de cette immense question. Et bien sûr, il faut toujours savoir que l’on retrouve des hommes sur ces versants et des femmes sur l’autre, que l’on n’est pas assigné à son genre. L’important pour moi dans ce qui se passe aujourd’hui n’est pas la ré-assignation, mais bien la
reposer toutes les questions, une fois que l’on s’est libéré de certains jougs : il y a récemment le Polyphonie Penthésilée de Liliane Giraudon, le Dehors dehors d’Anna Serra et tant d’autres, je ne veux pas dresser de liste. Cette énergie, cette force-fragilité, cette langue tout à la fois défective et guerrière, en tension permanente, est peut-être une langue qui caractérise plus encore certaines femmes poètes qui ont l’énergie des anciens parias comme l’ont été certains hommes bien sûr, comme l’a été Villon, comme l’ont été des hommes dans des situations d’effacement ou de fragilité, Kafka ou Nerval, on pense aujourd’hui à Dominique Quélen ou Christophe Manon et d’autres encore. Mais je me garderai de prétendre faire le tour de cette immense question. Et bien sûr, il faut toujours savoir que l’on retrouve des hommes sur ces versants et des femmes sur l’autre, que l’on n’est pas assigné à son genre. L’important pour moi dans ce qui se passe aujourd’hui n’est pas la ré-assignation, mais bien la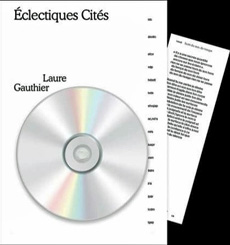 possibilité du neutre, de pouvoir dépasser le genre. La capacité à aller par-delà les frontières du genre, à se mouvoir sur les différents versants par-delà les cultures sociales, culturelles et politiques du masculin et du féminin, est pour moi ce qui est le plus intéressant dans les débats actuels. Mon album Eclectiques Cités est un album que j’appelle transpoétique pour déjouer les assignations à un genre poétique comme à un genre sexuel. Dans mes textes je dialogue avec des écritures amies : Gérard de Nerval, François Villon, Dante, Denis Roche, Novalis, Antonin Artaud, mais aussi avec Christine de Pizan, Sappho, Inès de la Cruz, Ingeborg Bachmann ou encore Nelly Sachs ainsi que bien des contemporain.e.s.
possibilité du neutre, de pouvoir dépasser le genre. La capacité à aller par-delà les frontières du genre, à se mouvoir sur les différents versants par-delà les cultures sociales, culturelles et politiques du masculin et du féminin, est pour moi ce qui est le plus intéressant dans les débats actuels. Mon album Eclectiques Cités est un album que j’appelle transpoétique pour déjouer les assignations à un genre poétique comme à un genre sexuel. Dans mes textes je dialogue avec des écritures amies : Gérard de Nerval, François Villon, Dante, Denis Roche, Novalis, Antonin Artaud, mais aussi avec Christine de Pizan, Sappho, Inès de la Cruz, Ingeborg Bachmann ou encore Nelly Sachs ainsi que bien des contemporain.e.s.

Je ne peux pas caractériser moi-même mon écriture. Je laisse à d’autres le soin de le faire. J’ai choisi à un moment de m’inscrire dans la tradition, jusque-là exclusivement masculine, d’un hommage à François Villon. J’ai écrit à ma façon un livre « villon », je neige (entre les mots de villon) (LansKine, 2018), ce qui s’est fait de Rabelais à Rimbaud, de Tzara à Manon. Mon livre cherche davantage à continuer une musique philanthropique, à chercher dans l’énergie des vers de Villon une capacité à résister aux assignations et n’entend pas le réinstaller en poète buveur et paillard ; je tente de dialoguer avec ce que soulève son écriture, la force transgressive de ses vers. Kaspar de pierre (La lettre volée, 2017) pose autrement la question de la violence de notre société positiviste à partir du sort tragique de Kaspar Hauser dont le moi est effacé, ouvert à tout vent, comme un symptôme de notre société capitaliste et positiviste ; dans La Cité dolente, que Catherine Tourné va rééditer chez LansKine en mars 2023, s’écrit un dialogue avec l’Enfer de Dante ; on trouve une remise en question de la « littérature comme tauromachie », et un sauvetage de ce que Leiris, préférant le mythe, appelait avec dédain « les vaines grâces de ballerine ». C’est un livre qui traverse différents mécanismes de violence aujourd’hui, qui touche au statut de l’image, du langage, des faits divers dans lequel on retrouve un féminicide, mais pas seulement. On y frôle bien des mécanismes de la violence individuelle et collective et en ce sens le livre est politique.
de villon) (LansKine, 2018), ce qui s’est fait de Rabelais à Rimbaud, de Tzara à Manon. Mon livre cherche davantage à continuer une musique philanthropique, à chercher dans l’énergie des vers de Villon une capacité à résister aux assignations et n’entend pas le réinstaller en poète buveur et paillard ; je tente de dialoguer avec ce que soulève son écriture, la force transgressive de ses vers. Kaspar de pierre (La lettre volée, 2017) pose autrement la question de la violence de notre société positiviste à partir du sort tragique de Kaspar Hauser dont le moi est effacé, ouvert à tout vent, comme un symptôme de notre société capitaliste et positiviste ; dans La Cité dolente, que Catherine Tourné va rééditer chez LansKine en mars 2023, s’écrit un dialogue avec l’Enfer de Dante ; on trouve une remise en question de la « littérature comme tauromachie », et un sauvetage de ce que Leiris, préférant le mythe, appelait avec dédain « les vaines grâces de ballerine ». C’est un livre qui traverse différents mécanismes de violence aujourd’hui, qui touche au statut de l’image, du langage, des faits divers dans lequel on retrouve un féminicide, mais pas seulement. On y frôle bien des mécanismes de la violence individuelle et collective et en ce sens le livre est politique.

Je finis d’écrire en ce moment un long récit poétique Mélusine reloaded et ce texte s’inscrit dans le prolongement d’Outrechanter (La lettre volée, à paraître 2023), à savoir d’un retour vers le conte, comme genre non-national, ouvert, hybride, cosmopolite, transgressif, à l’encontre de l’épopée qui serait un fantasme rétrograde, celui d’une terre, d’un ancrage, d’une grandeur perdue. Je plaide pour le courage du vers libre et pour ne pas resservir les plats du passé, ne pas refaire sonnet. Mélusine est pour moi la figure littéraire féminine par excellence, 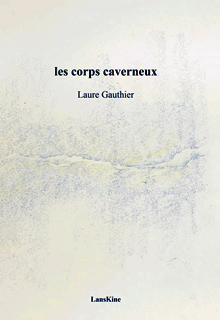 objet de fantasmes. Catholicisée dans le récit de Jean d’Arras, rendue mère de dix fils partis faire la guerre, notamment dans le cadre des croisades, femme-enfant et objet de fantasme pour André Breton, ou pseudo-sorcière aujourd’hui. J’essaie de remettre en circulation ce qu’elle est : une image de la transgression, qui échappe aux normes, à toutes les fixations. La poésie comme échappée belle. Je m’intéresse particulièrement aux « lieux communs » culturels que sont Kaspar Hauser, Dante, Villon ou Mélusine, des figures historiques ou fictives ou des récits qui traversent les siècles et donnent lieu à de nombreuses réécritures, ou encore les cavernes préhistoriques, les EHPAD, les asiles, la vieillesse, l’adolescence, le désir ou la mort, qui sont des lieux de dépôt de toutes nos questions, de nos libertés, qui nous touchent tous et toutes, des lieux qui abritent des questions tues et portent des germes d’avenir. Je cherche à remettre en mouvement et en question des sujets qui sont ou sont devenus des images d’Epinal, inertes à force d’habituation.
objet de fantasmes. Catholicisée dans le récit de Jean d’Arras, rendue mère de dix fils partis faire la guerre, notamment dans le cadre des croisades, femme-enfant et objet de fantasme pour André Breton, ou pseudo-sorcière aujourd’hui. J’essaie de remettre en circulation ce qu’elle est : une image de la transgression, qui échappe aux normes, à toutes les fixations. La poésie comme échappée belle. Je m’intéresse particulièrement aux « lieux communs » culturels que sont Kaspar Hauser, Dante, Villon ou Mélusine, des figures historiques ou fictives ou des récits qui traversent les siècles et donnent lieu à de nombreuses réécritures, ou encore les cavernes préhistoriques, les EHPAD, les asiles, la vieillesse, l’adolescence, le désir ou la mort, qui sont des lieux de dépôt de toutes nos questions, de nos libertés, qui nous touchent tous et toutes, des lieux qui abritent des questions tues et portent des germes d’avenir. Je cherche à remettre en mouvement et en question des sujets qui sont ou sont devenus des images d’Epinal, inertes à force d’habituation.
Je m’intéresse aussi particulièrement au conte, à notre capacité à apporter des variantes aux contes séculaires car ça touche à notre capacité à transformer les grands récits, à les interroger et aussi à transformer notre vision de la société. Il ne s’agit pas seulement pour moi de citer des contes, mais véritablement de continuer leur écriture. Sans chercher à revenir à des mythes. Démythifier la langue, c’est la débarrasser des restes patriarcaux, mais c’est aussi inventer de nouveaux chemins de poésie, de pensée et aussi de société.
Je ressens assurément cette nécessité d’être vive, cet impératif du contemporain (pas de l’actuel, du contemporain, Agamben l’a bien dit), présent bien sûr pour les hommes poètes mais tout particulièrement pour les femmes poètes chez qui l’avenir à encore plus à dire que le passé, puisque presque tout est pour elles est à construire.
ghostwriter
Charles sentait la présence de mélusine s’immiscer ; il sentait de nouveau les fibres de sa chemise exister, un corps réel tenir debout. « Christine aurait dû écrire ton histoire », lui dit-il, comme s’ils avaient entretenu depuis des années une conversation. Il le lui dit avec sa voix non déraillée, avec sa voix confiante et douce, à peine perchée, sachant qu’elle ne chercherait ni le lys ni le lit, qu’elle venait le rencontrer de côté. Christine p. aurait su t’écrire un chemin et ne pas fixer ton mouvement de pensée, continua charles d’un souffle. « Elle savait pertinemment les boniments de la rose et les débordements des contes, elle savait s’arracher à l’histoire et tenait bon dans sa solitude dressée. Le soir je m’imagine à ses côtés, nous sommes deux poumons où respirer. »
« Elle a bien fait de me laisser dans la marge. » C’est ce que mélusine répondit. « Elle a bien fait de répondre au roman plein de roses et de s’attaquer aux faits d’armes pour exister. Mais je crois aux fantômes du passé, je crois aux récits prolongés, à cette marge continuée, depuis hier jusqu’à demain, un autre horizon tracé : ni l’acte ni l’idéal mais un entre-deux avoué ».
Charles fuyait le lys et les chroniques, comme mélusine fuyait les fées et les contes récupérés. Ils étaient faits pour se rencontrer. De biais.
« Je suis venue voir de près comment l’on m’a immobilisée, comment l’on m’a greffé une histoire empierrée et dépassée, comment jean de berry a fixé mon sort en demandant à l’autre jean de m’attacher à une lignée, de me coller une famille sur le dos. J’ai été attachée au poitou, aux lusignan, à la croix même, ficelée, saucissonnée l’année où tu as transpercé le lys royal à coup d’épée en déposant ton nom au pied des cadavres accumulés, l’année où tu as entendu la plainte venant des bas-côtés. 1392, la chasse au papillon. Papillon monarque, papillon sphinx enfermés. Sous la vitrine versifiée ou narrée. Comment échapper ?
Je veux faire l’amour à ton corps de 1392, je veux sentir sous mes doigts l’août terrifiant, je veux le traverser autrement, je veux en désirer l’oublié. Oublions ensemble l’enluminure froissée, la forêt du monde ; je veux entendre autrement ton chant de bataille, la peine que tu ne voulais pas infliger, l’énergie de vivre dans ton fessier, tout ce qui s’est cabré dans ta pensée au même moment que ton cheval révulsé ; je veux accueillir et embrasser le cabré obturé, la chambre noire évincée. Je veux percer des microsillons dans ton histoire, d’où jaillirait l’inécouté. Pas de quoi en faire un lais. Je te désire jusqu’au rein, jusqu’à la peau de côté, jusqu’à l’odeur âcre, je te désire jusqu’à ton blanc sur mes cheveux, sur mes yeux, je te désire jusqu’à être trempés, jusqu’à l’odeur de bosquet et la douleur chevillée. Je te désire entre-deux. Loin d’Épinal. »
1392, pensait charles. « Qui sait 1392 ? », continua charles. « 26 000 cadavres de hollandais, l’histoire le certifie. Moi, à cheval, non loin de la bataille, c’est avéré, estampillé. Mais l’odeur des cadavres faisandés, la peur au ventre du cheval qui n’aime pas plus que moi l’odeur du sang frais mêlé à la diarrhée des soldats, à la brume épaisse et grasse, et cette suzeraineté empoisonnée – une diarrhée généralisée. Quelques hommes lettrés écrivent l’ordre de bataille, j’ai 13 ans, je traîne avec moi l’absence de mon père qui me sert de manteau froid ; l’orphelin couvert d’un manteau de lys attend à cheval, nimbé de brouillard épais et cerclé d’une nappe d’agonie : étaient-ce des sons ou des images ? Une pensée ? Au front, ils poursuivent les pensées de quelques lettrés, portent une idée du pays, un idéal peu partagé mais scellé. Toi, mélusine qui me viens : tu es de l’autre côté, le versant éclairé, le rêve en pointillé, l’échappée belle, enfermée ; moi je suis du côté du fait acté, prisonnier, consigné. Christine savait, elle a fait un pas de côté, une traversée des roses, elle savait le roman mythé. L’épopée viciée.
Quand j’ai entendu les armes blanches en forêt du mans et aperçu mes camarades en lambeaux à 23 ans, quand j’ai su prévoir la bataille, deviner son prix, on m’a enfermé. On m’a ressorti à temps pour voir les restes calcinés des danseurs et des princes charivariés, un soir de fête feinte. Et quand on a envoyé les médecins m’observer, me saigner, espérant voir l’angoisse s’atrophier, en vain, on les a débités par quartiers, on en a écartelé pensant m’apaiser. Et ton sabbat peut-il accueillir ces odeurs, ces craintes accumulées ? Toi qui viens du pays aseptisé qui se croit hors de portée ?
Les arbres de la forêt du mans ont vu les restes oubliés, ce qui n’a pas fait chronique, il faudrait leur demander. La mémoire ne sait se souvenir ; pourras-tu faire apparaître l’oublié ? ‘Le roi de france prend le commandement de l’armée et quitte le mans pour la bretagne le 5 août 1392’ : c’est ce que tu as lu, n’est-ce pas ? On va te dire la couleur de mon chaperon, rouge, également, la couleur, noire, du velours de ma robe et de mes chausses ; on sait, cette fois que je cheminais en avant. En fièvre, poussé par mes marmusets, par les oncles, pressés d’aller venger olivier le premier. Mais je charriais les 26 000 cadavres, je les traînais avec moi ; le bruit du métal, comme une composition infernale, rythmée, en contre-bas ; on m’avait piégé en voulant m’épargner ; à cheval, enfiévré, je tenais derrière moi le frère qui voudrait peut-être me faire cramer ; le frère que j’ai ensuite menacé. Ils voulurent mettre mon corps en tête d’une armée pour venger celui que j’ai aimé, celui qui, à treize ans, m’a offert son aine, sa hanche forte et bonne, sa nuque dégagée, celui auquel j’ai donné mes lèvres imberbes, ma foi de côté. Inexpérimenté. Qu’est-ce que la france, cette entité gouvernée par mes oncles plusieurs fois meurtriers ? J’ai tenté de gouverner avec des hommes sans titre, des hommes denses qui m’aidaient à régner sans terreur, qui savaient s’emparer d’une ville sans trop lourd tribu à payer, sans têtes décapitées, sans les têtes exhibées, pieuses. Se passer du féroce. C’était fou de le désirer. Acculé par le désir avunculaire. Abandonné aux grégaires. Le bel enculé courageux qui pouvait aimer olivier pour sa justice et mélusine pour sa justesse. Je naviguais dans un entre-deux qu’ils ont saccagé. Quelles étincelles dans un pas de côté ? Qu’ai-je brûlé si ce n’est moi ? »
« Je suis venue te dégager », dit mélusine. « Sans lais, sans idéal apprêté, j’ai suivi ta trace calcinée, j’ai su te trouver, un roi sans promesses qui a essayé ». « Tu m’as regardé et j’ai levé les yeux vers toi », dit charles. « Tu t’es immiscée dans l’histoire, loin de la neige qui seule m’écoutait. Viens à mon contact, mélusine, viens me lécher, viens me transformer, hors des lais, toi seule qui peut éventrer l’Histoire. La renouveler.
La fonte des peurs, pourléchées. »
Si l’on devait mouler l’instant, en resterait-il un chant ? Un fantôme écrit toujours. On ne peut que le désirer, sans se faire avaler, un pas de côté fera tomber l’ordre des choses dissimulé ; fera tomber le masque, la grimace des idéaux avoués ou du cynisme dissimulé.
« L’interdit du monde est une boîte à musique qui le fait danser », dit mélusine alors. D’une voix claire. Puis, elle continua : « J’habite un monde bougé qui ne sait plus danser, un monde emprunté, affecté, où chaque geste est épié, chaque geste te suit sans pensée. On est tous évidé de pensée. Les marmousets sont loin et il est toujours des oncles tapis quelque part, on ne sait plus par quel bout commencer, par où les attraper. On ne meurt plus dans des clairières dégagées, la plainte est fracturée, atomisée. D’un monde qui meurt d’une fausse complexité. Notre peine est perdue. Je suis venue chercher un chemin sous tes reins. Un chemin pour pouvoir la nommer.
On m’a fait entrer en paysage pour m’y enfermer. On m’a noyée dans une soupe bucolique, genrée. Je suis venue te rechercher. christine et toi allaient me sauver – vous qui savez l’ordre inversé, vous qui aviez percé les suzerainetés, qui savez vous balader entre les lais.
Je suis venue voir ta peau réelle, je suis la veuve clisson, je porterai ton deuil autrement, transporterai tes bourgeons oubliés sous ma peau, les ferai pousser tous les samedis ; à même l’interdit, parmi les amandiers imaginés. »
![[Entretien - création] Ce que les femmes font à la poésie (9) : Laure Gauthier](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/01/PenthesileeBackG.jpg)

![[Entretien – création] Ce que les femmes font à la poésie (9) : Laure Gauthier](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/01/band-penthesilee.jpg)