Alors qu’Althusser s’éloignait du PCF à la fin des années 1970, Lefebvre s’y replongea. La décennie a poussé et tiré les socialistes et les communistes partout, inaugurant autant l’effondrement de la gauche d’après-guerre que du capitalisme d’après-guerre. Gramsci aurait pu appeler cela un interrègne, entre un passé mourant et une nouvelle ère encore à naître, hantée entre-temps par des monstres. Pendant un temps, la gauche en France a appelé à l’unité, à une « Union de la gauche » ; une unité populaire pour éloigner les monstres, entre le PCF et le Parti socialiste (PS), en solidarité avec les autres fractions et forces de gauche – évitant, d’un côté, le dogmatisme et le sectarisme dans ses propres rangs, et luttant, de l’autre, à forger un pacte électoral, un socialisme des urnes.
La gauche européenne prenait ses distances avec Moscou, abandonnant son engagement envers la  « dictature du prolétariat », embrassant à la place ce qu’on appelle « l’eurocommunisme » – « la voie démocratique vers le socialisme ». Le mouvement ouvrier avait besoin de lutter pour des réformes structurelles, de transformer le système capitaliste par étapes et gradations, pour finalement le modifier en profondeur. Il faut éviter l’affrontement frontal entre bourgeoisie et prolétariat ; le socialisme sans le consensus d’une large majorité de la population « progressiste » serait impossible. Plutôt que de prendre d’assaut la forteresse ennemie, d’un seul coup, les eurocommunistes avaient besoin d’encercler cette forteresse, de la saper progressivement, de la rejeter, d’éroder son pouvoir. Plus tard, ils pourraient prendre le contrôle, démocratiser l’État.
« dictature du prolétariat », embrassant à la place ce qu’on appelle « l’eurocommunisme » – « la voie démocratique vers le socialisme ». Le mouvement ouvrier avait besoin de lutter pour des réformes structurelles, de transformer le système capitaliste par étapes et gradations, pour finalement le modifier en profondeur. Il faut éviter l’affrontement frontal entre bourgeoisie et prolétariat ; le socialisme sans le consensus d’une large majorité de la population « progressiste » serait impossible. Plutôt que de prendre d’assaut la forteresse ennemie, d’un seul coup, les eurocommunistes avaient besoin d’encercler cette forteresse, de la saper progressivement, de la rejeter, d’éroder son pouvoir. Plus tard, ils pourraient prendre le contrôle, démocratiser l’État.
Althusser a pensé qu’il s’agissait d’une grave erreur tactique, d’une trahison des classes ouvrières, et l’a signifié après la défaite électorale de l’Union en 1978 ; Lefebvre semblait plus ouvert, plus curieux de son exploration, plus prêt à affronter la réalité. Althusser a écrit une série d’articles fulgurants en avril 1978, publiés en feuilleton dans le journal Le Monde, sur les raisons pour lesquelles il pensait que le syndicat de gauche s’était effondré et sur « Ce qui doit changer dans le parti ». Il a dit que le Parti devait sortir de sa propre « forteresse », embrasser le mouvement populaire, avoir plus confiance dans la base. Le « centralisme démocratique » ne pourrait fonctionner, selon Althusser, que si le PCF desserrait son emprise absolutiste sur le mouvement ouvrier. Hélas, les gros bonnets du parti s’étaient davantage souciés de défendre leurs privilèges institutionnels contre le PS que de s’allier pour combattre une bourgeoisie nationale.
Lefebvre a également publié un texte en 1978, une année cruciale dans la disparition de la  gauche-un livre européen avec un titre révélateur : La révolution n’est plus ce qu’elle était, un échange dialogique avec Catherine Régulier, la jeune mariée de Lefebvre et jeune militante PCF. Althusser y est fréquemment mis au pilori par Lefebvre ; Régulier se range généralement du côté de son camarade du Parti contre son mari, ce qui rend la conversation particulièrement fascinante en raison de ses loyautés inextricables et enchevêtrées. Comme Althusser, Lefebvre est en désaccord avec Gramsci : le Parti n’est pas un prince moderne ; Staline a mis fin à de telles images. Pourtant, plutôt que d’orchestrer le « centralisme démocratique », Lefebvre veut développer et généraliser « l’autogestion », une autogestion de type ouvrière, poussant le Parti à accepter plus de décentralisation ; le pouvoir nécessaire dévolu aux communes locales ; une action directe plus coordonnée nécessitait d’être encouragée au niveau du sol. Lefebvre, en effet, recherchait une ligne démocratique entre le Parti et l’État, souhaitant que les deux disparaissent.
gauche-un livre européen avec un titre révélateur : La révolution n’est plus ce qu’elle était, un échange dialogique avec Catherine Régulier, la jeune mariée de Lefebvre et jeune militante PCF. Althusser y est fréquemment mis au pilori par Lefebvre ; Régulier se range généralement du côté de son camarade du Parti contre son mari, ce qui rend la conversation particulièrement fascinante en raison de ses loyautés inextricables et enchevêtrées. Comme Althusser, Lefebvre est en désaccord avec Gramsci : le Parti n’est pas un prince moderne ; Staline a mis fin à de telles images. Pourtant, plutôt que d’orchestrer le « centralisme démocratique », Lefebvre veut développer et généraliser « l’autogestion », une autogestion de type ouvrière, poussant le Parti à accepter plus de décentralisation ; le pouvoir nécessaire dévolu aux communes locales ; une action directe plus coordonnée nécessitait d’être encouragée au niveau du sol. Lefebvre, en effet, recherchait une ligne démocratique entre le Parti et l’État, souhaitant que les deux disparaissent.
Étienne Balibar, ancien élève et confident d’Althusser, et co-auteur avec son professeur de Reading Capital, a pu reconnaitre que Lefebvre et Althusser se sont effectivement rencontrés durant cette période mouvementée. Ils se sont rencontrés avec d’autres théoriciens marxistes (comme Christine Buci-Glucksmann et Jean-Marie Vincent) dans l’appartement de Lefebvre, rue Rambuteau (donnant sur le Centre Pompidou). Balibar précise qu’il s’agissait de « réunions privées », organisées par un autre ancien étudiant d’Althusser, Nicos Poulantzas, dont l’idée était « d’essayer de réunir les intellectuels marxistes et de relancer, si possible, le débat de gauche et l’Union de la gauche en détresse
 « Lefebvre était vieux, se souvient Balibar, mais très alerte et un causeur charmant. Il voulait que la gauche « enterre les vieilles haches », qu’elle surmonte ses divergences et désaccords internes, que chacun fasse la paix les uns avec les autres. Peut-être se souvenait-il de ce que Lénine disait des marxistes et des anarchistes ? Qu’il y avait neuf dixièmes de similitude et un dixième de différence. N’en était-il pas de même pour les humanistes et les anti-humanistes ? « Althusser était souvent malade et absent à cette époque », se souvient Balibar. « Il est venu quelquefois aux réunions sans dire grand-chose, parfois sans rien dire du tout. » « Lefebvre, raconte Balibar, m’a dit que les Presses universitaires de France lui avaient commandé un livre sur « Marx aujourd’hui ». « Pourquoi ne le faisons-nous pas ensemble ? ».
« Lefebvre était vieux, se souvient Balibar, mais très alerte et un causeur charmant. Il voulait que la gauche « enterre les vieilles haches », qu’elle surmonte ses divergences et désaccords internes, que chacun fasse la paix les uns avec les autres. Peut-être se souvenait-il de ce que Lénine disait des marxistes et des anarchistes ? Qu’il y avait neuf dixièmes de similitude et un dixième de différence. N’en était-il pas de même pour les humanistes et les anti-humanistes ? « Althusser était souvent malade et absent à cette époque », se souvient Balibar. « Il est venu quelquefois aux réunions sans dire grand-chose, parfois sans rien dire du tout. » « Lefebvre, raconte Balibar, m’a dit que les Presses universitaires de France lui avaient commandé un livre sur « Marx aujourd’hui ». « Pourquoi ne le faisons-nous pas ensemble ? ».
Les travaux de Lefebvre et Althusser au cours de cette décennie, à partir de perspectives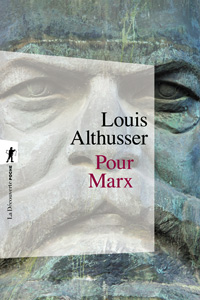 différentes, ont tenté de valoriser pour la gauche un État capitaliste en crise. Une gauche unifiée pourrait-elle détourner le pouvoir de l’État d’une droite mécontente ? Pourrait-il le faire dans les rues, dans les usines et par les urnes ? Les forces à l’intérieur de l’État pourraient-elles être modifiées par une pression organisée de l’extérieur ? La pression de l’extérieur pourrait-elle non seulement transformer l’intérieur, mais en fait devenir cet intérieur ? « On s’engage », disait Althusser, « et puis on voit. » Et pourtant, après s’être engagé, après avoir sauté dans la mêlée, ce que l’on a vu était un changement de pouvoir dramatique, une transition et un renouveau dans le sens inverse qui était prévu. C’est la droite qui s’est ressaisie, qui a serré les rangs, dont le pouvoir de classe s’est « condensé », tout comme la gauche s’effondrait, alors que son unité se brisait en désunion.
différentes, ont tenté de valoriser pour la gauche un État capitaliste en crise. Une gauche unifiée pourrait-elle détourner le pouvoir de l’État d’une droite mécontente ? Pourrait-il le faire dans les rues, dans les usines et par les urnes ? Les forces à l’intérieur de l’État pourraient-elles être modifiées par une pression organisée de l’extérieur ? La pression de l’extérieur pourrait-elle non seulement transformer l’intérieur, mais en fait devenir cet intérieur ? « On s’engage », disait Althusser, « et puis on voit. » Et pourtant, après s’être engagé, après avoir sauté dans la mêlée, ce que l’on a vu était un changement de pouvoir dramatique, une transition et un renouveau dans le sens inverse qui était prévu. C’est la droite qui s’est ressaisie, qui a serré les rangs, dont le pouvoir de classe s’est « condensé », tout comme la gauche s’effondrait, alors que son unité se brisait en désunion.
Au milieu des années 1980, beaucoup d’idées sur l’unité populaire et la démocratisation de l’État, sur le triomphe de l’eurocommunisme, se sont effondrées, ont été rejetées, presque avant que les votes ne soient exprimés. D’une manière ou d’une autre, son programme avait été trop compromis ; ou bien n’avait pas fait assez de compromis. C’était comme si la gauche ne savait pas si elle allait ou venait, ne sachant plus sur quelles jambes se tenir. Il avait chassé à la fois le Parti et le Peuple, entravé boiteux. Pourtant, contrairement à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, « la gauche » a néanmoins triomphé en France, en 1981, sous le Parti socialiste de François Mitterrand ; pourtant la victoire est vite devenue Pyrrhique, alors que sa politique « gauchiste » commençait à s’inspirer directement du manuel de la droite. D’ici là aussi, dans un Paris embourgeoisé, un octogénaire Lefebvre avait été expulsé de sa location de la rue Rambuteau et un Althusser déprimé avait étranglé sa femme bien-aimée, Hélène, dans un moment de « folie temporaire », mettant fin à ses jours de personnalité publique. Poulantzas, quant à lui, avait paniqué dans l’appartement d’un ami, se jetant par la fenêtre dans une défenestration suicidaire impulsive.
Soudain, la « Nouvelle Droite » s’est lancée dans sa longue marche, nous disant qu’il n’y a plus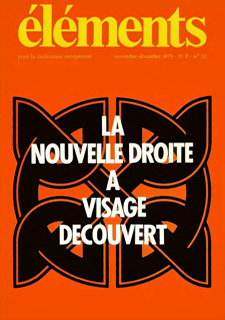 de société, mais que des individus et des familles. De la lutte pour assurer un État providentiel, il n’y avait apparemment plus d’État, mais un Etat seul préparant le terrain politique pour le développement de l’entrepreneuriat de marché libre. Ainsi surgit une situation délicate pour les progressistes, en particulier pour les théoriciens marxistes : ces articles de « consommation collective » si vitaux pour la reproduction des rapports de production, si indispensables pour soutenir la demande dans l’économie et pour satisfaire les besoins de la classe ouvrière – le logement social et les infrastructures, les hôpitaux et les biens et services consommés collectivement étaient mis de côté. Comment cela pourrait-il être ? Ce qui apparaissait autrefois comme des ingrédients essentiels pour la reproduction continue du capitalisme,
de société, mais que des individus et des familles. De la lutte pour assurer un État providentiel, il n’y avait apparemment plus d’État, mais un Etat seul préparant le terrain politique pour le développement de l’entrepreneuriat de marché libre. Ainsi surgit une situation délicate pour les progressistes, en particulier pour les théoriciens marxistes : ces articles de « consommation collective » si vitaux pour la reproduction des rapports de production, si indispensables pour soutenir la demande dans l’économie et pour satisfaire les besoins de la classe ouvrière – le logement social et les infrastructures, les hôpitaux et les biens et services consommés collectivement étaient mis de côté. Comment cela pourrait-il être ? Ce qui apparaissait autrefois comme des ingrédients essentiels pour la reproduction continue du capitalisme,
La gauche n’a jamais vraiment accepté une secousse sismique qui a enregistré de gros chiffres sur l’échelle néolibérale de Richter. Les années 1980 ont fait leurs adieux au réformisme social-démocrate, à une époque où le secteur public était la solution aux malheurs du capitalisme et le secteur privé le problème. Désormais, le premier avait besoin d’être nié, disaient les idéologues de droite ; le secteur privé était la solution et un secteur public même remodelé ne pouvait qu’accroitre le problème. Les bureaucrates de l’État distribuant des articles de consommation collective à travers un principe de justice redistributive ont cédé la place à la réalité dans laquelle le marché régnait. En gros, c’était le début des privatisations, d’une idéologie d’individualisme possessif. « Liberté » est devenu son slogan : les marchés libres, le libre-échange, le libre choix, la liberté de consommer, la liberté de faire sa propre chose.
Les générations successives ont été gavées de cette idéologie de la liberté, traitant tout ce qui est public, tout domaine de la nécessité, avec suspicion, comme relevant de ce qui est inefficace ou inefficient, comme quelque chose qui symbolise une liberté. Désormais, ce n’est plus une catégorie idéologique : c’est ancré dans le cerveau des gens, un système de croyances qui nous apprend à oublier, à se méfier de la sphère publique et donc à n’importe quel contrat social. Peut-être pour une bonne raison : l’État public a été tellement évidé qu’il est de mauvaise qualité. Ses fonctions de base – la planification et l’organisation des services publics – ont été sous-traitées à des consultants et entrepreneurs privés qui ont plus engrangé que fournit un service essentiel.
Et alors que la pandémie faisait rage, les pays qui avaient creusé leurs États le plus rapidement ont découvert qu’ils n’avaient ni la capacité matérielle ni le savoir-faire logiciel pour faire face à un problème de société massif. Ils ont donc distribué des millions à des consultants privés « experts » comme McKinsey, qui l’a apparemment fait. A prendre l’exemple de la Grande-Bretagne, ce dernier a mis en place un système de test et de traçage qui fonctionnait à peine, il a été réalisé que ces « experts » étaient également ignorants. COVID-19 a exposé et mis en exergue les lacunes de l’État privatisé, de l’incompétence des entreprises privées en matière de santé publique et de la façon dont les problèmes de santé publique ne peuvent être résolus par les individus et les familles seuls.
Il y a évidemment beaucoup de demandes et d’injonctions de protections collectives face à une pandémie mondiale. Mais la nécessité collective ne peut fonctionner que si les individus reconnaissent l’État comme « démocratique », distinguent le bon gouvernement du mauvais. De nos jours, dans les nations de types populistes, la démocratie semble relever d’une vision assez déformée. Nous pourrions appeler ces états non civils parce que les gens y ont perdu leur sens du devoir les uns envers les autres. Mais force est de reconnaître que beaucoup ont été trompés par des démagogues en nous faisant croire que nous sommes tous des agents libres capables de faire ce que nous aimons. Mais en cas d’impossibilité, quel en serait la cause ? Celle de l’Union européenne ? Grand gouvernement ? Rarement de grandes entreprises. Les inclinations privées ont bousculé les intérêts publics, les cultes de la personnalité sont devenus viraux. Peut-être des gens intelligents, inspirés par un certain V-effekt brechtien, pourraient un jour reconnaître à nouveau la société, pourraient se distancer des leurres et des mensonges de la classe dirigeante. Peut-être verrons-nous alors comment nous pouvons être plus libres si chacun de nous admet que nous faisons partie d’une culture publique qui a désespérément besoin de réparation collective, que le but de la démocratie socialiste est de lutter pour reconquérir le pouvoir public.
Nous pourrions également nous souvenir de Marx, qui a insisté sur le fait que la vraie liberté est effective et produite en répondant à la nécessité. « La liberté ne peut consister en l’homme socialisé, disait Marx, que lorsque les producteurs associés régulent rationnellement leur métabolisme avec la Nature. « Un raccourcissement de la journée de travail est la condition de base de la liberté », pensait-il. La vie s’épanouit sur une telle base, a-t-il concédé. La liberté sans nécessité relève encore plus d’un baratin bourgeois, une autre ruse idéologique pour perpétuer sa domination de classe. « La bourgeoisie vit dans l’idéologie de la liberté », nous dit Althusser, et nous y fait vivre aussi, forge son concept dans nos gorges. Mais la vraie liberté est difficile, lorsque vous devez vous soucier de faire le prochain chèque de loyer, lorsque vous vous demandez si votre emploi existera demain, ou ce qui se passe si vous tombez malade. Le libre choix ne signifie pratiquement rien quand vous êtes financièrement esclave. La liberté dans ce cadre-là n’est pas très humaniste. En effet, quand il s’agit d’anti-humanisme, le capitalisme a léché le marxisme à tout moment.
Sébastien Ecorce, Prof. de neurobiologie, enseignant, chercheur, cofondateur et responsable de la plateforme Neurocytolab, ICM, Salpêtrière, (poète).
![[Chronique] Sébastien Ecorce, Des formes de marxisme, humaniste et antihumaniste, revisitation et enjeux (2/2)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/05/greenmarxBackG.jpg)

![[Chronique] Sébastien Ecorce, Des formes de marxisme, humaniste et antihumaniste, revisitation et enjeux (2/2)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2021/05/reve-toi-et-marx.jpg)