Suite à la parution en décembre dernier de Polyphonie Penthésilée (P.O.L, 144 pages), mais également, en ce début janvier  2022, d’une anthologie proposée par Marie de Quatrebarbes aux éditions du Corridor bleu, Madame tout le monde, ce dossier qui emprunte son titre à l’une des sections de Polyphonie Penthésilée pour réunir entretiens, extraits (inédits pour la plupart) et chroniques, vise à donner un aperçu complémentaire de la création actuelle au féminin, tout en donnant la parole à des poétesses sur leurs pratiques comme sur les conditions qui leur sont faites dans cet espace éditorial de circulation restreinte : environ deux tiers d’entre elles (61,5% exactement) ont participé à l’une ou l’autre de ces deux aventures collectives cruciales que sont Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021) et Madame tout le monde ; ajoutons deux autres variables, l’âge (pour l’instant : une septuagénaire, une sexagénaire, une quinquagénaire, six quadragénaires et quatre trentenaires) et les lieux d’édition (une petite trentaine). Les trois mêmes questions sont posées à chacune afin de construire un éventail de réponses qui, à défaut de constituer une enquête conforme à tous les critères propres aux sciences sociales, n’en est pas moins significative.
2022, d’une anthologie proposée par Marie de Quatrebarbes aux éditions du Corridor bleu, Madame tout le monde, ce dossier qui emprunte son titre à l’une des sections de Polyphonie Penthésilée pour réunir entretiens, extraits (inédits pour la plupart) et chroniques, vise à donner un aperçu complémentaire de la création actuelle au féminin, tout en donnant la parole à des poétesses sur leurs pratiques comme sur les conditions qui leur sont faites dans cet espace éditorial de circulation restreinte : environ deux tiers d’entre elles (61,5% exactement) ont participé à l’une ou l’autre de ces deux aventures collectives cruciales que sont Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021) et Madame tout le monde ; ajoutons deux autres variables, l’âge (pour l’instant : une septuagénaire, une sexagénaire, une quinquagénaire, six quadragénaires et quatre trentenaires) et les lieux d’édition (une petite trentaine). Les trois mêmes questions sont posées à chacune afin de construire un éventail de réponses qui, à défaut de constituer une enquête conforme à tous les critères propres aux sciences sociales, n’en est pas moins significative.
Après l’entretien de Liliane GIRAUDON, de Sandra MOUSSEMPÈS, d’Aurélie OLIVIER, qui a dirigé le volume Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021), de Virginie LALUCQ, d’Elsa BOYER, de A.C. HELLO, de Marina SKALOVA, de Laure GAUTHIER, de Virginie POITRASSON, de Katia BOUCHOUEVA, d’Isabelle ZRIBI et de Séverine DAUCOURT, voici celui d’Aurélie Foglia.
Aurélie Foglia a porté un temps le nom de Loiseleur, sous lequel elle a commencé à publier en poésie (Hommage à Poe, La dame d’onze heures, 2007 ; Entrées en matière, Nous, 2010) ; ensuite, sous le nom de Foglia, Gens de peine (Nous, 2014). Son premier roman, Dénouement (Corti), est paru en 2019. Elle publie régulièrement dans des revues : Lirisme (Corti, 2022) a commencé sous forme de feuilleton de poésie dans la revue Catastrophes.
roman, Dénouement (Corti), est paru en 2019. Elle publie régulièrement dans des revues : Lirisme (Corti, 2022) a commencé sous forme de feuilleton de poésie dans la revue Catastrophes.
En parallèle elle est plasticienne, peintre d’arbres : une partie de ses toiles, détruites fin 2018 dans le cadre d’un articide, restent visibles sur son site www.a-foglia.com. Comment dépeindre (Corti, 2020) reprend le dialogue noué avec les arbres (amorcé avec Grand-monde, Corti, 2018) dans le dialogue entre les arts, poésie et peinture, et interroge la part encore trop fragile laissée à la création féminine.
Elle enseigne la littérature à l’Université Sorbonne Nouvelle et donne des ateliers d’écriture. Elle est également l’auteure d’essais (en 2023, Le Culte de l’impersonnalité, essai sur Charles Baudelaire, La Rumeur libre) et d’éditions critiques (Lamartine et Staël, Le livre de Poche et Folio Gallimard).
Entretien d’Aurélie Foglia avec Fabrice Thumerel
FT. Aujourd’hui, que font les femmes à la poésie ?
AF. La question touche juste à mon sens et trouve tout de suite à résonner en moi, car il ne s’agit pas platement de femmes qui font de la poésie, comme on ferait du tricot ou du stretching, mais de faire potentiellement quelque chose à la poésie à partir de sa féminitude, parce qu’on est femme, dans une action spécifique, plus ou moins consciente et revendiquée. Donc cette question me parle immédiatement parce qu’elle engage cette gestuelle profonde du faire, du creuser, du remuer, voire du déplacer. Est-ce qu’on arrive actuellement à changer quelque chose à la poésie en y touchant de main de femme ? Je ne peux pas parler au nom du général ; devant la complexité des enjeux, ma contribution va s’attacher ici à ma pratique, à son vécu médité.
Je parle en poète, en essayiste aussi recueillant-compilant de l’expérience de poète puisque je prépare un essai intitulé Penser de tout son corps, qui ne peut pas ne pas se pencher sur cette question de l’écrire-femme. Elle m’a longtemps gênée, et je l’ai évacuée, la chassant de ma tête pour y revenir plus tard. Mais avec les années elle revient me tarauder, parce que ce dont je suis sûre, pour le sentir en moi, c’est que je n’écris pas qu’avec ma tête, loin de là. J’écris de tout mon corps, j’écris avec mon sexe. Et ce n’est pas une provocation obscène, je l’écris parce que c’est vrai, parce que mon écriture se noue ailleurs que dans mon cerveau, ça doit être dans ces zones-là où je sens que ça se conçoit et s’accouche au féminin (désolée de reprendre la métaphore usée de la maternité mais rien à faire, il y a de ça). De plus ce sexe de la poésie n’est pas localisable, il se diffuse dans tout le corps.
Au début je ne me posais pas la question, j’écrivais avec un sujet universel, un neutre. Mais tout dépend de ce qu’on écrit. S’il va bien, sobre et abstrait, dans une démarche philosophique, il sonne nettement moins juste dans un poème, qui n’a pas le même rapport au monde ni aux mots. Et c’est donc la question qui est venue se poser à moi, d’elle-même, à partir de ce qui sortait de mon corps par la main : qui était celle-là qui disait je, si ce je était une elle tacite, cryptée.
Nous sommes maintenant beaucoup, des centaines, des milliers de femmes à publier, en France, à travers le monde, à donner de la voix, le tissu se densifie, ajoutons à cela le travail d’éditrices et d’éditeurs pour qui c’est un enjeu de taille, qui en sont habités,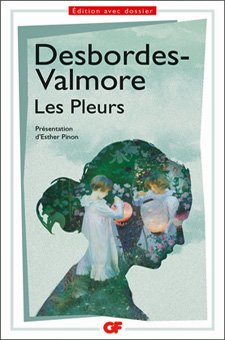 sans oublier les traductrices et les traducteurs qui font circuler les poèmes à travers le monde de langue en langue, de main en main. Rien à voir avec le XIXème siècle où à peine quelques noms timidement surnageaient, souvent tournés en dérision. Comme je donne cette année le cours d’agrégation sur Marceline Desbordes-Valmore je peux d’autant mieux l’affirmer, qu’on a eu longtemps de la poésie féminine une idée si restreinte et si mièvre que ça donnerait presque envie de pleurer. Marceline elle-même vaut tellement mieux que ses titres, Les Pleurs, Pauvres fleurs, Bouquets et Prières, qui sentent la cuvée fadasse, la cueillette de glaneuse à la sauvette dans le champ de blé des grands propriétaires terriens de la langue, les mages romantiques, Lamartine, Hugo et tout le bataillon. On le voit aussi chez ceux (les critiques-écrivains mâles) qui disent, en substance : lisez, bien que ce ne soit qu’une femme. Trouvant de la force dans cette faiblesse, ils entonnent son éloge, mais sur le mode d’une misogynie affichée. Elle-même se situe hors champ, elle en a parfaitement conscience, et qu’elle enfreint, qu’elle empiète, elle ne peut pas s’en empêcher, bravant une interdiction absolue, passant outre une frontière invisible : « Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, / J’écris pourtant ». Est-ce que dans cette contradiction elle perd sa nature de femme ? Je ne crois pas, je pense qu’elle la tire ailleurs, emportant la poésie avec elle.
sans oublier les traductrices et les traducteurs qui font circuler les poèmes à travers le monde de langue en langue, de main en main. Rien à voir avec le XIXème siècle où à peine quelques noms timidement surnageaient, souvent tournés en dérision. Comme je donne cette année le cours d’agrégation sur Marceline Desbordes-Valmore je peux d’autant mieux l’affirmer, qu’on a eu longtemps de la poésie féminine une idée si restreinte et si mièvre que ça donnerait presque envie de pleurer. Marceline elle-même vaut tellement mieux que ses titres, Les Pleurs, Pauvres fleurs, Bouquets et Prières, qui sentent la cuvée fadasse, la cueillette de glaneuse à la sauvette dans le champ de blé des grands propriétaires terriens de la langue, les mages romantiques, Lamartine, Hugo et tout le bataillon. On le voit aussi chez ceux (les critiques-écrivains mâles) qui disent, en substance : lisez, bien que ce ne soit qu’une femme. Trouvant de la force dans cette faiblesse, ils entonnent son éloge, mais sur le mode d’une misogynie affichée. Elle-même se situe hors champ, elle en a parfaitement conscience, et qu’elle enfreint, qu’elle empiète, elle ne peut pas s’en empêcher, bravant une interdiction absolue, passant outre une frontière invisible : « Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, / J’écris pourtant ». Est-ce que dans cette contradiction elle perd sa nature de femme ? Je ne crois pas, je pense qu’elle la tire ailleurs, emportant la poésie avec elle.
Rien que le fait qu’on la mette au programme d’un concours, c’est bon signe (même s’il faut se méfier de l’effet de mode, qui peut démoder tout aussi vite des questions pourtant fondamentales). C’est un signe d’existence, de reconnaissance. Et on sait que les processus de légitimation sont longs et lents à se mettre en place, dans une société. Parce qu’il faut tout changer, tout réévaluer, alors que tout est si figé, tant au niveau des représentations collectives qu’au niveau des institutions, ça prend des siècles. Si nous guettons des signes ça frémit, ça se dessine. Il y a des avancées. Bref nous ne sommes plus des parias, c’est déjà ça. Ou disons, pas plus que les poètes masculins, devant l’incompréhension générale qui entoure la manifestation-poésie maintenant (ou plutôt ne l’entoure pas, s’en détourne). Pourtant je ne viens pas ici faire preuve de satisfaction, ni dire qu’on frôle la parité et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. Je suis venue saluer tout d’abord mes consœurs et puis répondre à la deuxième question, qui me brûle les lèvres depuis le début.
FT. Remise en question, la domination masculine est encore d’actualité dans le milieu poétique. Est-ce à dire qu’un #MeToo y serait également nécessaire ?
AF. Je ne m’imaginais pas avoir un jour des choses à dire sur ce point, je veux dire à titre personnel, vu que je n’ai jamais attisé la guerre des sexes. Pourtant il y a le réel, c’est-à-dire l’événement, c’est-à-dire le trauma. Il se trouve qu’une nuit de décembre 2018, mon ex-concubin a détruit l’intégralité de mon œuvre de peintre, l’a lacérée, éventrée, défenestrée dans le jardin. Pourquoi ? Parce que mon éditrice, Corti, venait de refuser son manuscrit de poésie, après POL, Nous et d’autres. Le drame c’est que je publiais, moi, et que c’était pour lui sous ses yeux une chose impardonnable. La joie que je trouvais dans la peinture à main nue, il ne pouvait pas la tolérer non plus. C’est pourquoi ce meurtre symbolique, cent cinquante toiles massacrées à ma place.

La police, que j’ai appelée plusieurs fois en suppliante sous le coup de la terreur, ne s’est pas dérangée, ne m’a pas protégée. J’ai porté plainte, notamment devant les instances de mes filles qui voulaient voir leur mère debout, et non plus toujours subissant, elles en avaient besoin. La justice n’a rien fait. Il était plus dommageable dans sa logique qu’il s’en soit pris au passage à mes habits ou de la vaisselle ! J’étais sidérée. Devant un tel vide juridique je me suis dit que peut-être quand on nomme une chose elle existe davantage, entrant pour tous dans la langue, et j’ai forgé le mot d’articide sur celui de féminicide et d’écocide (je ne peignais que des arbres). Fatalité non seulement individuelle, mais aussi sociale, planétaire : là où caressante, ma main de femme avait accompagné la naissance de formes végétales, la main de l’homme mâle était revenue abattre.
En tombant sous la coupe d’un dominateur, en vivant sous son emprise, j’ai connu l’esclavage moderne, les dérives jusqu’au délire de la phallocratie sur tous les plans. Non, ce ne sont pas de pures caricatures de féministes fanatico-hystériques – si seulement ce  n’étaient que fictions, contes de combat ! Je m’en tiens ici à ce qui nous occupe, la question de l’écriture, de la création au féminin. J’ai appris à mes dépens que l’espace de création laissé à la femme est encore trop menacé, trop vulnérable, même si chacune s’acharne à l’inventer à tâtons. L’inventer ne suffit pas, il semblerait qu’il faille encore le défendre. L’articide c’est quand on vous intime : tu ne créeras pas. Tout à l’heure j’ai conjugué au passé : je peignais. Non seulement mon œuvre de peintre a été détruite, mais j’ai été amputée de la peinture. Le geste était parti. Je ne voyais plus rien. Sans doute c’est le plus grave. Qui peindra ma désolation dans ce jardin noir ? J’ai pensé que je n’étais sans doute pas seule à traverser ce deuil, et j’ai voulu lancer un collectif pour recueillir des témoignages d’artistes victimes d’articide. Bien évidemment les hommes ne sont pas exclus, la violence n’a pas de sexe, bien que tout de même les statistiques prouvent que les femmes en sont tellement plus souvent les victimes. Maud Thiria, qui allait publier Trouée, livre sur la tentative d’étranglement d’une femme, m’a rejointe sur le projet. Il y a une page facebook dédiée, j’ai vu qu’A. C. Hello en parle dans son entretien.
n’étaient que fictions, contes de combat ! Je m’en tiens ici à ce qui nous occupe, la question de l’écriture, de la création au féminin. J’ai appris à mes dépens que l’espace de création laissé à la femme est encore trop menacé, trop vulnérable, même si chacune s’acharne à l’inventer à tâtons. L’inventer ne suffit pas, il semblerait qu’il faille encore le défendre. L’articide c’est quand on vous intime : tu ne créeras pas. Tout à l’heure j’ai conjugué au passé : je peignais. Non seulement mon œuvre de peintre a été détruite, mais j’ai été amputée de la peinture. Le geste était parti. Je ne voyais plus rien. Sans doute c’est le plus grave. Qui peindra ma désolation dans ce jardin noir ? J’ai pensé que je n’étais sans doute pas seule à traverser ce deuil, et j’ai voulu lancer un collectif pour recueillir des témoignages d’artistes victimes d’articide. Bien évidemment les hommes ne sont pas exclus, la violence n’a pas de sexe, bien que tout de même les statistiques prouvent que les femmes en sont tellement plus souvent les victimes. Maud Thiria, qui allait publier Trouée, livre sur la tentative d’étranglement d’une femme, m’a rejointe sur le projet. Il y a une page facebook dédiée, j’ai vu qu’A. C. Hello en parle dans son entretien.

La question reste : nommer ou non ? En pratique on hésite, on recule, on a sa pudeur, on ne veut pas faire de vagues, on répugne à donner dans le déballage d’horreurs. Surtout, l’idée de garder le moindre lien avec son bourreau suscite une peur panique qui reste intacte malgré le temps. Quand j’ai écrit sur Facebook que je me retrouvais sans domicile après la destruction de mon œuvre (j’avais trop peur, je ne pouvais plus rentrer chez moi) je ne nommais personne ; pourtant tout de suite deux comparses de mon ex-concubin m’ont téléphoné pour exiger que je retire mon post, parce que certains de mes contacts auraient pu en déduire que c’était lui, l’auteur de ces violences, ce qui aurait risqué de nuire à sa réputation. Tremblante, aux abois, j’ai cédé aux pressions. Pourquoi ai-je continué à céder, à subir ?

Le silence tue. Trop de femmes meurent en silence, meurent du silence. Trop de profond silence entoure ces morts sans un cri. J’ai vu des écoutantes, à l’époque, qui m’ont dit, si vous qui écrivez vous ne témoignez pas, qui le fera ? La victime, quand elle se tait, protège son prédateur, c’est un fait. Et ce silence ne l’autorise-t-il pas à resserrer son poing en toute impunité sur une nouvelle proie ? On m’a dit rédige une tribune, contacte un journaliste : rien, personne. C’était visiblement moins qu’un fait divers, rien d’intéressant pour le grand public. On peut critiquer la déferlante #MeToo, mais au moins elle a eu une vraie efficacité de dénonciation. Elle a fait que le silence a paru soudain moins étouffant, que la main étrangleuse d’abuseurs de tout poil s’est desserrée sur des gorges privées d’air et de parole. Bien au-delà des règlements de compte, des violences si péniblement ravalées ont pu devenir des récits. Des noms ont couru, des coupables ont pris des visages. Sans compter que le pire châtiment, pour un pervers, c’est sans doute la réprobation publique, vu qu’il tient à son image plus qu’à tout.
En poésie, à l’université, on n’en a pas parlé. Je veux dire, outre mon cas anecdotique, de #MeToo. J’étais étonnée qu’il n’y ait pas  de remuement parmi les étudiantes, par exemple. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé, loin de là. Cela veut simplement dire, à mon avis, qu’il n’y a pas eu d’espace de parole ni de solidarité suffisante des muselées. Toujours la peur, raser les murs, se cacher, tourner la page, tirer un trait (sauf que l’inconscient travaille, que le corps a sa mémoire et qu’on n’oublie pas comme on voudrait). Toujours la pesanteur de plomb, toujours la fascination pour le Puissant, le tout-Parlant, l’idée que le Grand Penseur et le Grand Artiste peuvent se servir de l’humain selon leur bon plaisir, eux qui se croient si supérieurs à tous qu’ils se sentent forcément aussi au-dessus des lois. Et de porter aux nues Sade et Bataille, penseurs-paravents commodes pour les pratiquants de la violence sous toutes ses formes… Certains ont dû avoir quelques sueurs froides, et puis se rassurer. Je pense qu’à notre tour il ne faut pas lâcher. Au bout de décennies d’inertie sociale et de souffrances secrètes, certains combats finissent par être mûrs. Seule on ne peut rien. Il faut un courage collectif pour savoir s’en saisir, et que l’inacceptable éclate au grand jour.
de remuement parmi les étudiantes, par exemple. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé, loin de là. Cela veut simplement dire, à mon avis, qu’il n’y a pas eu d’espace de parole ni de solidarité suffisante des muselées. Toujours la peur, raser les murs, se cacher, tourner la page, tirer un trait (sauf que l’inconscient travaille, que le corps a sa mémoire et qu’on n’oublie pas comme on voudrait). Toujours la pesanteur de plomb, toujours la fascination pour le Puissant, le tout-Parlant, l’idée que le Grand Penseur et le Grand Artiste peuvent se servir de l’humain selon leur bon plaisir, eux qui se croient si supérieurs à tous qu’ils se sentent forcément aussi au-dessus des lois. Et de porter aux nues Sade et Bataille, penseurs-paravents commodes pour les pratiquants de la violence sous toutes ses formes… Certains ont dû avoir quelques sueurs froides, et puis se rassurer. Je pense qu’à notre tour il ne faut pas lâcher. Au bout de décennies d’inertie sociale et de souffrances secrètes, certains combats finissent par être mûrs. Seule on ne peut rien. Il faut un courage collectif pour savoir s’en saisir, et que l’inacceptable éclate au grand jour.
FT. En fin de compte, bien qu’il n’y ait pas d’écriture féminine (à bas l’essentialisme), en quoi peut consister cette « langue/introuvable » qui serait celle des femmes selon Liliane Giraudon ?
AF. Je suis chercheuse ; chercheuse est mon métier, mon état permanent, ma raison d’être. Alors oui, cette langue introuvable je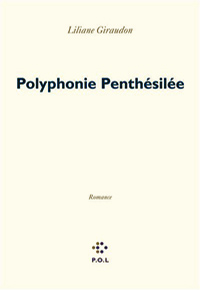 la cherche. Je la cherche dans les recoins, partout, plus loin. On voit, plus haut, que je me suis heurtée à l’innommable, que je me suis retrouvée main coupée, langue coupée.
la cherche. Je la cherche dans les recoins, partout, plus loin. On voit, plus haut, que je me suis heurtée à l’innommable, que je me suis retrouvée main coupée, langue coupée.
Pendant des années j’ai voulu écrire un roman sur les amazones, ne serait-ce que la façon dont les Grecs ont voulu les faire passer
pour des monstres, prêtes à se couper un sein pour égaler les hommes au combat. L’étymologie même du mot amazone est ambivalente : le mot signifie-t-il les sans-seins, ou au contraire les mamelles-nombreuses ? On leur a collé l’étiquette de la tribu dénaturée, auto-mutilée, alors qu’il me semble que c’était plutôt ça, leur peuple, un grand corps épanoui, allaitant. Dans mon manuscrit, je croisais ces réminiscences d’un passé à la lisière du mythe avec un récit contemporain sur un cancer du sein, qui peut entraîner l’ablation. Quand j’ai lu Liliane Giraudon, surtout Madame Himself, avant sa toute récente Penthésilée, j’ai renoncé : c’était là, c’était fait.
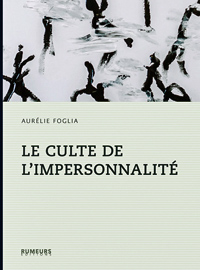 Quand je peignais j’écrivais Comment dépeindre (Corti, 2020). Au fil de ce journal d’atelier, ce qui se déployait c’était un geste de la poésie vers la peinture, et réciproquement. Je suivais. La dernière saison de ce livre, « Vous désarticulées » a dû prendre acte de la destruction. Se confronter à l’irrattrapable. J’ai été jetée hors de chez moi, hors de la peinture, hors de toute langue. Mon corps ne répondait plus. La mort rôdait. Depuis, la résilience a été puissante, j’ai connu la renaissance. Mais il me reste à trouver la forme, la formule, pour dire ce que je ne peux pas dire, à supposer qu’il y ait une langue pour cela. Tout résiste, tout est hérissé d’interdits (sociaux, genrés, génériques, juridiques, etc.). Ce dont je suis sûre, c’est que si une œuvre est décorative, dispensable, elle ne vaut pas la peine qu’on insiste. Quand elle tire, quand elle appelle, on la porte en soi, elle vient. Je suis hantée par mon histoire, une histoire de femme. Elle tient à l’histoire de la femme, dans une dialectique de l’effacement-élargissement qui mobilise la capacité qu’a l’expérience, en devenant texte, de se charger de l’intensité du personnel-partagé. À tâtons, j’essaie. J’échoue. Je recommence. Je continue.
Quand je peignais j’écrivais Comment dépeindre (Corti, 2020). Au fil de ce journal d’atelier, ce qui se déployait c’était un geste de la poésie vers la peinture, et réciproquement. Je suivais. La dernière saison de ce livre, « Vous désarticulées » a dû prendre acte de la destruction. Se confronter à l’irrattrapable. J’ai été jetée hors de chez moi, hors de la peinture, hors de toute langue. Mon corps ne répondait plus. La mort rôdait. Depuis, la résilience a été puissante, j’ai connu la renaissance. Mais il me reste à trouver la forme, la formule, pour dire ce que je ne peux pas dire, à supposer qu’il y ait une langue pour cela. Tout résiste, tout est hérissé d’interdits (sociaux, genrés, génériques, juridiques, etc.). Ce dont je suis sûre, c’est que si une œuvre est décorative, dispensable, elle ne vaut pas la peine qu’on insiste. Quand elle tire, quand elle appelle, on la porte en soi, elle vient. Je suis hantée par mon histoire, une histoire de femme. Elle tient à l’histoire de la femme, dans une dialectique de l’effacement-élargissement qui mobilise la capacité qu’a l’expérience, en devenant texte, de se charger de l’intensité du personnel-partagé. À tâtons, j’essaie. J’échoue. Je recommence. Je continue.
Inédit : Aurélie Foglia, « On.e »
Ces poèmes sont extraits de mon prochain livre de poésie, qui s’appelle On.e.
On.e est un indéfini
féminin.
Flottant. Habillée
de cheveux longs.
Porte une veste en laine
d’homme parfois.
Sur ses épaules. Et
bien sûr le monde.
Dans son ventre. On
la fait porter.
On.e est le féminin
d’on. Sa femelle sans
nom. Moi.e toi.e
quelqu’une.
Un elle elliptique.
À mort.
Un ventre rond
Comme. De la terre.
——–
On.e est mon pronom
sans être. Tout le monde
à un moment peut se
pronommer on.e. Ou
un autre.
Même pas une façon. De voir
ni un ventre plein. De terre.
———
On.e est originaire. D’un peu
partout au fond.
On.e est à la mode. A
une fréquence très élevée.
Il suffit d’aller se
changer. De prendre un bain
de foule facile. On.e ne
cherche qu’à se noyer.
Réussit. Plus fourre-tout
il n’y a pas.
C’est agaçant ce pronom
en pointillé qui ne va pas.
Jusqu’au nom. On aimerait.
Connaître. Rencontrer.
On.e est fugace. Re
produit l’enlèvement
de la vie. Sa ponctuation
qui tombe. Bien ou mal.
—————-
Qu’apporte on.e
à on ?
Le fameux e.
On.e y tient.
C’est sa marque
amovible. Sa raison
d’être. D’inêtre
aussi. Trop répandue.
On.e étant faite pour
s’effacer. De couleur
chair.
—————
On.e est associée.
S’accompagne
d’un catalogue de clichés.
Lesquels l’escortent
comme une nuée. Un
essaim. Qui
la masque non sans
une certaine. Efficacité.
C’est pourquoi on.e
ne peut pas être. Vue
nue.
On.e ne reste pas. Part
en paillettes de poussières.
Se dissipe se. Dissout.
La photo reste. Floue.
————-
Sous l’angle de l’anglais
on.e se prononce
one. On l’a en bouche
autrement. Quand
la langue fond les sexes en
semble. Gomme
les contours dans le même
trou. N’opère pas
la différence. Se
refuse.
One fond. One
se fond.
One se pronomme
quiconque.
Ne s’accorde plus. C’est
une libération.
————
On.e n’est pas
quelqu’un. À
n’avoir pas
de corps.
On.e prend.
Sert.
Se sert.
S’emmêle à tout
ce qui se mélange.
Se fait l’écho.
Ce n’est qu’un portrait
probable :
On.e à l’auto.
———–
On.e boit au futur
autrefois. Du temps
où rien n’arrivait.
Dans cette prison
classique du coffre
fort. Du corps parqué.
Le passé a un poids
mort à ses pieds.
Maintenant on.e
se risque. Sort
de soi. Palpite.
Pour de vrai.
Agite sa jupe
mûre.
En boîte.
On.e s’éclate.
———-
Dur retour
du pur.
Du rien que.
À moins que
du vague.
Ils répètent
de ne pas.
De jamais ne.
Mais on.e
est sans.
L’ombre
d’une.
N’en fait
qu’à son corps.
Ni plafonds ni
murs qui tiennent.
On.e est si vague. Une
eau gazeuse.
————
« Le temps me
femme. »
On.e veux dire vivre
veut dire.
Fendre en femme
fendue.
Traverser la mer
résistante du réel
par ses failles.
Passée.
Mer rouge. Jamais
ne se referme.
Mer souple. Et
trouble au goût
de corps dont
le sol s’ouvre.
Sans gravité.
On.e vole.
Voudrait.
Le soleil trop haut
citronne. Lèche le sel
sur sa statue courante.
Diminue.
———
On.e est
mer.
Presque. De la grande
eau secouée
dans sa cuvette.
Houle houle
fait le bruit du cri.
Impression nue.
Plusieurs.
On.e arpente pensive.
Le rivage caressé
par le clapotement
calme de la mer
claire comme. Cœur
amoureux se réfléchit
à ce rythme.
Conjuguée. Lance
ses oiseaux dans un jeu
sans conclusion.
Ausculte ce souffle
Se. Sculpte dans ce sable.
Seul.
———–
Ce n’est pas une guerre.
Pourtant. Tout
se précipite sous
les apparences les
plus unies. Riantes.
On l’entrecoupe
et l’é.Trangle. La
torture et débite.
Lui arrache les mots.
De la bouche. Viole
son univers. Écrasée
sous le coup. De la colère
on.e rampe plie
supplie en morceaux.
C’est un scénario.
Banal.
Qu’on la batte. On.e
s’abandonne. Faute
de posséder son propre
corps. On.e n’en finit pas
de mourir chaque jour.
Par centaines.
——–
![[Entretien-création] Ce que les femmes font à la poésie (14) : Aurélie Foglia](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/01/PenthesileeBackG.jpg)

![[Entretien-création] Ce que les femmes font à la poésie (14) : Aurélie Foglia](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/01/band-penthesilee.jpg)
→
oh merci Aurélie Foglia pour ce poème qui m’a emporté, après que les réponses aux questions de Fabrice Thumerel (merci pour ces entretiens) m’aient soulevées de ma chaise avec une envie de crier à la lune. Merci.